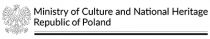◁ Retour au concert du mar. 4 nov. 2025
Programme détaillé
Capriccio pour quatuor à cordes en mi mineur, op. 81/3
[6 min]
Quatuor à cordes n° 4, en do mineur, op. 18/4
I. Allegro ma non tanto
II. Andante scherzoso, quasi allegretto
III. Menuetto : Allegretto – Trio – Menuetto da capo (la seconde fois, prendre un tempo plus vif)
IV. Allegro – Prestissimo
[23 min]
--- Entracte (10 minutes) ---
Fantaisie pour quatuor à cordes en do majeur
[9 min]
Quintette avec piano en sol mineur, op. 34
I. Allegro
II. Adagio
III. Scherzo
IV. Finale
[35 min]
Distribution
Quatuor Equilibrium
Tobias Koch piano-forte
Avec le soutien du ministère de la Culture et du Patrimoine national de Pologne.
Introduction
Fondé en 2017 par quatre musiciens rompus au répertoire des XVIIIe et XIXe siècles, le Quatuor Equilibrium s’est hissé au sein des meilleurs ensembles historiquement informés et s’est donné pour mission d’explorer les pans méconnus de la musique de chambre classique et romantique, notamment polonaise. Avec Tobias Koch, ils s’assurent la complicité d’un des meilleurs spécialistes actuels des claviers anciens, partenaire de musiciens comme Andreas Staier, Joshua Bell ou Steven Isserlis. Leur programme s’organise autour de deux pièces majeures : le Quatuor à cordes en do mineur (1799), le plus impétueux et dramatique de l’Opus 18, premier ensemble de quatuors à cordes publié par Beethoven ; et le somptueux Quintette avec piano de Juliusz Zarębski, ultime partition de cette étoile filante morte à 32 ans, qui la dédia à son mentor, Franz Liszt. Les musiciens font précéder ces partitions de deux courtes pièces : le Capriccio de Mendelssohn, composé en 1843 mais publié de manière posthume dans un recueil de quatre pièces pour quatuor à cordes, et la Fantaisie composée vers 1823 par Karol Kurpiński, compositeur plus connu à la scène (il fut pendant près de vingt ans le directeur musical de l’Opéra de Varsovie), qui influença profondément le jeune Chopin.
Texte : Auditorium-Orchestre national de Lyon
Mendelssohn, Capriccio
Composition : 1843.
Publication : en février 1850, de manière posthume.
Le Capriccio de Felix Mendelssohn est extrait des Quatre Pièces pour quatuor à cordes op. 81, un étonnant recueil publié de manière posthume en février 1850. S’y trouvent rassemblés des mouvements composés à des époques différentes : un thème et variations écrit en 1847, un scherzo de 1847, ce capriccio de 1843 et une fugue de 1827. Leur réunion est parfois présentée comme le septième quatuor de Mendelssohn, mais ils constituent en réalité des mouvements isolés, d’autant qu’aucun lien thématique ne les unit. Ils sont par conséquent souvent interprétés séparément.
Le Capriccio déploie deux grandes sections. La première est un Andante porté par la longue mélodie lyrique du premier violon ; son souple balancement et son atmosphère mélancolique n’est pas sans rappeler certaines des Romances sans paroles. La seconde section est une fugue, dont le sujet nerveux est imité, échangé entre les différents instruments.
– Nathan Magrecki
Beethoven, Quatuor op. 18/4
Composition : été et automne 1799.
Dédicataire : au prince Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz.
Avec son Opus 18, Ludwig van Beethoven fait ses premières armes dans le genre du quatuor à cordes. Composés de fin 1798 à l’été 1800, à la demande du prince Lobkowitz, ces six quatuors opèrent une synthèse stylistique entre l’héritage du classicisme viennois de Haydn et Mozart, et les innovations que Beethoven développera dans le reste de sa production.
Le Quatuor n° 4 est écrit au cours de l’été et de l’automne 1799 ; il s’agit donc de l’avant-dernier à avoir été composé. Il se singularise au sein de l’Opus 18 par sa tonalité mineure, qui lui donne un caractère grave et dramatique. Cet éthos est particulièrement perceptible dans l’Allegro ma non tanto initial, animé d’une inquiétude haletante et hérissé de brusques accents et de ruptures dramatiques. Un Andante scherzoso quasi allegretto tient la place habituellement dévolue au mouvement lent ; il apporte un contraste saisissant par la légèreté de ses motifs, en notes répétées et brèves, dans un staccato presque pointilliste, et par son écriture fuguée pleine d’esprit. Le Menuetto renoue avec l’atmosphère du premier mouvement ; à son trio central, plus détendu, succède une reprise du menuet dans un tempo plus rapide, qui en accroît la tension et le dramatisme. Enfin, le Finale est un rondo qui voit l’alternance d’un refrain immuable, tourbillonnant et tempétueux, et de couplets contrastants.
– N. M.
Kurpiński, Fantaisie
Composition : autour de 1823.
La production de Karol Kurpiński est majoritairement consacrée à la musique vocale et dramatique, qu’il tenait pour supérieure aux autres formes d’expression musicale. L’un des sommets de sa carrière est en effet son poste de directeur musical de l’Opéra de Varsovie, qu’il occupe de 1823 à 1840 ; acteur incontournable de la vie musicale polonaise, il exerce une influence importante sur le jeune Chopin.
Dans toute l’œuvre de Kurpiński, seuls cinq opus relèvent donc de la musique de chambre, pour diverses formations ; et une seule œuvre est écrite pour quatuor à cordes : la Fantaisie en do majeur, composée autour de 1823. Cette œuvre est d’abord connue à travers une transcription pour piano seul, publiée à Leipzig en 1823 ; sa version originale ne sera redécouverte et publiée qu’en 1986.
Dans sa forme comme dans son climat, l’œuvre se réfère aux fantaisies de l’époque classique, caractérisées par leur liberté formelle, qui voient des épisodes de longueurs variables se succéder, avec des types d’écriture et des atmosphères contrastées. Le plus souvent, elles déploient volontiers un caractère dramatique, d’abord inspiré par le courant du Sturm und Drang («Tempête et Passion»), dont le romantisme reprendra les codes.
Le déroulement musical de la Fantaisie de Kurpiński est ainsi très fragmentaire, comme s’interrompant et passant sans cesse d’une idée à l’autre. Quatre grandes sections enchaînées les unes aux autres se détachent cependant, unies par de nombreux retours et rappels thématiques : un Adagio, une vaste Fugue, un Moderato suivi d’un Andante, et un étourdissant Presto final.
– N. M.
Zarębski, Quintette avec piano
Composition : 1885.
Dédicataire : Franz Liszt.
Lorsqu’il compose son Quintette avec piano en sol mineur, op. 34, en 1885, la renommée de Juliusz Zarębski n’est pas vraiment celle d’un compositeur mais bien celle d’un immense pianiste virtuose. En effet, en 1874, près de dix ans auparavant, il prend la route de Rome pour étudier avec Franz Liszt, dont il devient l’un des élèves favoris. Mort prématurément de la tuberculose, il signe sa dernière œuvre avec l’opus 34, qu’il dédie à son mentor ; l’œuvre ne sera éditée qu’en 1931, de manière posthume.
Loin de tout effet démonstratif ou de velléité solistique, il ne cherche pas à y confier au piano un rôle de premier plan ; au contraire, il l’intègre à la texture des cordes, ne le faisant ressortir de l’ensemble qu’avec parcimonie. Dans le premier mouvement, le piano fournit ainsi un fond sonore grondant, qui peu à peu enfle pour porter le premier élément thématique tragique et passionné. L’Adagio, tripartite, commence par une mystérieuse introduction, dont aucune réelle mélodie ne semble se dégager. La première section du mouvement voit son thème confié au violon, dans le grave de son registre, tandis que la partie centrale débute par un épisode lyrique dévolu au piano seul, qui n’est pas sans évoquer certaines pages de Chopin. Le scherzo voit deux textures s’opposer : un galop frénétique et angoissé, présenté en premier ; et un thème d’inspiration populaire, léger et presque grotesque, plus tard traité en fugato. Le Finale est caractérisé par son thème vigoureux et joyeux, marqué par le rythme dactylique (longue, deux brèves) ; mais il frappe surtout par les retours thématiques des mouvements précédents qui le parsèment : le thème du scherzo lui sert d’interlocution, tandis que celui confié au violon dans mouvement lent reparaît juste avant la brillante coda finale.
– N. M.
Polska
Amie séculaire de la France, la Pologne se distingue par une richesse musicale extraordinaire et une scène artistique foisonnante. La saison 2025/2026 de l’Auditorium met en lumière ces trésors, offrant une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les œuvres de compositeurs tels que Szymanowski, Lutosławski, Bacewicz, Szpilman, Zarębski, Kurpiński, Weinberg, Tansman et bien sûr Chopin. Des artistes polonais de renom – Marta Gardolińska, Karol Mossakowski, l’ensemble Arte dei Suonatori, le Quatuor Equilibrium, entre autres – nous honorent par ailleurs de leur présence à Lyon, apportant leur talent pour enrichir ce fil rouge artistique aussi captivant qu'original.