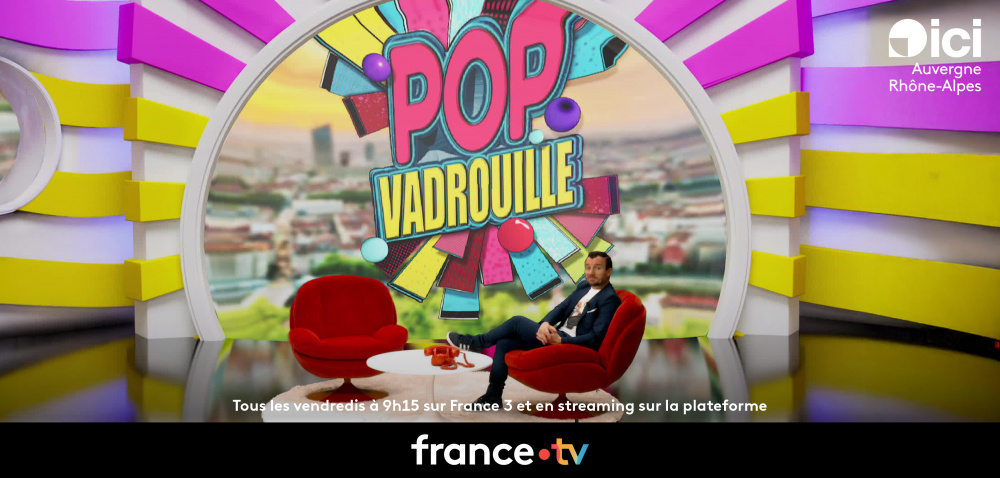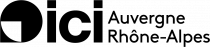◁ Retour aux concerts des ven. 28 nov. et sam. 29 nov. 2025
Programme détaillé
Concerto pour violoncelle n° 1, en ut majeur, Hob.VIIb:1
I. Moderato
II. Adagio
III. Finale : Allegro molto
[25 min]
--- Entracte ---
Manfred, symphonie en quatre tableaux d’après le poème dramatique de Lord Byron, op. 58
I. Lento lugubre – Moderato con moto
II. Vivace con spirito.
III. Andante con moto.
IV. Allegro con fuoco
[60 min]
Distribution
Orchestre national de Lyon
Vasily Petrenko direction
Kian Soltani violoncelle
Ici Auvergne-Rhône-Alpes partenaire de l’événement.
Introduction
Depuis sa venue en avril 2019 dans le concerto d’Elgar, Kian Soltani a fait du chemin. L’ancien violoncelle solo de l’Orchestre du Divan occidental-oriental (l’orchestre où Daniel Barenboim rassemble musiciens d’Israël et des pays arabes voisins) a déployé sa carrière des États-Unis au Japon et fait fructifier le contrat exclusif qui le lie à Deutsche Grammophon. Il a également développé avec Vasily Petrenko, le directeur musical de l’Orchestre royal philharmonique de Londres, une complicité qui fera merveille dans ce petit joyau de grâce et de bonne humeur qu’est le premier des deux concertos pour violoncelle de Haydn. Composé vraisemblablement entre 1762 et 1765 pour le violoncelle solo de l’orchestre de la cour du prince hongrois Nicolas Esterházy, dont Haydn était le maître de chapelle, il séduit par le soin de sa facture, qui n'empêche nullement le brio du soliste. Ensuite, nous serons prêts à plonger dans les tableaux colorés de Manfred (1885), symphonie en quatre tableaux inspirée par le poème dramatique homonyme de Lord Byron et sorte de pendant tchaïkovskien à la Symphonie fantastique de Berlioz. Paisibles paysages champêtres et montagnards, antres infernaux, danses féeriques et bacchanales, amours contrariées et mort sur fond de Dies iræ : Manfred est une aventure sonore saisissante.
Texte : Auditorium-Orchestre national de Lyon
Haydn, Concerto pour violoncelle n° 1
Composition : entre 1762 et 1765.
Création : vraisemblablement dans ces années par Joseph Weigl père et l’orchestre de la cour du prince Esterházy, à Fertőd (Hongrie).
On ne prête qu’aux riches et, déjà de son vivant, Joseph Haydn s’était vu attribuer des œuvres qu’il n’avait jamais écrites, pour le seul profit d’éditeurs peu scrupuleux. Ainsi a-t-on cru naguère que son catalogue comptait quatre concertos pour violoncelle et orchestre. Vérification faite, on ne lui en attribue plus que deux avec certitude : celui qu’on entendra ce soir, en ut majeur (retrouvé inédit en 1961), l’autre en ré majeur, dont le succès ne s’était jamais démenti depuis sa publication en 1806 mais jugé d’authenticité douteuse jusqu’à la découverte, en 1953, de l’autographe daté de 1783.
Deux décennies séparent ces œuvres destinées à la même formation (deux hautbois, deux cors et cordes) qui partagent les mêmes qualités de brio et de virtuosité sans que l’intérêt se limite à cela. L’inépuisable richesse de l’inspiration, la fluidité du déroulement où le matériau thématique est en perpétuelle mutation feraient presque oublier les prouesses du soliste, tant les traits volubiles qui volent sous son archet participent intimement à la progression du discours. Aux antipodes, donc, du bavardage accompagné qui, chez des compositeurs de moindre envergure, se prévaut indûment du titre de concerto.
Les thèmes des mouvements vifs ont de l’élan (rythmes pointés) et du rebond (syncopes) tandis que le lyrisme de l’Adagio, coulant et brodé, est tout d’intériorité méditative. Si Haydn l’a confié aux seules cordes c’est pour en préserver le caractère intime, car la tonalité de fa majeur autorisait l’utilisation des cors et des hautbois. Le retour des vents, dans le finale, n’en sera que plus saillant quoique leur rôle reste très limité : doubler les cordes ici et là pour en rehausser la couleur et se taire dès que le violoncelle soliste prend la parole pour éviter d’entrer en concurrence acoustique. Car, si rayonnant que puisse être le timbre de l’instrument, sa tessiture centrale le rend très vulnérable. Sans doute l’auditeur n’a-t-il pas à se soucier des précautions et des ruses du compositeur, mais un coup d’œil dans l’atelier aide à prendre la mesure de l’artiste, sauf à avouer qu’elle nous dépasse…
– Gérard Condé
Tchaïkovski, Symphonie «Manfred»
Composition : mai-septembre 1885.
Dédicace : à Mili Balakirev.
Création : Moscou, 23 mars 1886, sous la direction de Max Erdmannsdörfer.
Manfred est la plus vaste symphonie de Tchaïkovski, mais elle n’est pourtant pas comptée au nombre des six symphonies du compositeur. En effet, Tchaïkovski opérait une distinction nette entre les œuvres où le compositeur exprime sa propre subjectivité par la «musique pure», et celles où il tente de traduire en musique un sujet littéraire ou tout autre argument extramusical, qu’elles soient appelées «poème symphonique», «ouverture», «fantaisie» ou même «symphonie» à programme, sur le modèle des symphonies de Berlioz.
La genèse de Manfred prend son origine dans une sollicitation de Mili Balakirev, compositeur qui avait été le chef de file du groupe des Cinq dans les années 1860. Lors du second et dernier voyage de Berlioz en Russie (pendant l’hiver 1867-1868), Balakirev prit contact avec celui-ci pour lui proposer le sujet d’une nouvelle œuvre, d’après le drame de Byron résumé dans un argument dû à la plume du critique d’art Vladimir Stassov. Plein d’enthousiasme pour le compositeur français, Balakirev lui décrivit une sorte de symphonie idéale qu’il aurait pu composer, tenant de la Symphonie fantastique, de Harold en Italie et de Roméo et Juliette. Mais Berlioz, dont la santé était chancelante (il mourra l’année suivante), déclina la proposition, ayant d’ores et déjà cessé de composer.
Cependant Balakirev n’avait pas abandonné son projet de Manfred, et, sans doute faute de pouvoir le traiter lui-même (il était sujet à une inhibition créatrice persistante), il le proposa en 1882 à Tchaïkovski (ce n’était pas la première fois qu’il lui offrait un sujet, puisqu’il avait déjà suscité et supervisé la composition du poème symphonique Roméo et Juliette en 1869-1870). Tchaïkovski commença par hésiter, notamment parce que Schumann avait déjà traité le sujet dans son poème dramatique Manfred, op. 115, que Tchaïkovski admirait profondément. Mais Balakirev revint à la charge deux ans plus tard, et Tchaïkovski finit par accepter, composant avec détermination une monumentale partition en seulement quatre mois de travail acharné pendant l’été 1885.
Se posant en mentor, sinon en chef d’école autoritaire, Balakirev avait fourni à Tchaïkovski des éléments esthétiques et techniques précis, jusqu’à un plan tonal détaillé, et une liste d’œuvres de Berlioz, Liszt et Chopin à prendre comme modèles ! Selon lui, le thème musical représentant Manfred devait revenir dans chaque mouvement à la manière d’une «idée fixe», comme dans la Symphonie fantastique et Harold en Italie de Berlioz. Son travail achevé, Tchaïkovski s’excusa auprès de Balakirev, qui était considéré par d’aucuns comme «l’homme le plus redoutable au monde», de n’avoir pas suivi à la lettre toutes ses injonctions :
«Croyez-moi, jamais de ma vie je ne me suis donné autant de mal et ne me suis autant fatigué. La symphonie est écrite en quatre mouvements, suivant votre programme. Mais je vous prie de m’excuser, je n’ai pas pu observer toutes vos indications de tonalités et de modulations bien que j’aie désiré le faire […]. L’œuvre est très difficile et nécessite un orchestre énorme, c’est-à-dire surtout une grande quantité d’instruments à cordes […]. Manfred vous est bien sûr dédié» (lettre de Tchaïkovski à Balakirev, 13 septembre 1885).
Néanmoins, Balakirev se montra satisfait, et Manfred recueillit des critiques positives lors de ses premières auditions à Moscou puis Saint-Pétersbourg, louant notamment l’écriture orchestrale magistrale du compositeur.
Dans le drame de Byron (1817), Manfred est le type même du héros romantique rebelle et maudit, drapé dans sa solitude grandiose, attiré par l’abîme, fasciné par le monde de l’ombre et de l’invisible.
Premier tableau
«Manfred erre sur les Alpes. Poursuivi par les obsédantes questions de l’être, torturé par le désespoir et le souvenir de son passé criminel, il est en proie aux pires tourments de l’âme. Manfred a pénétré les mystères profonds de la magie, et communique avec autorité avec les forces de l’Enfer, mais ni elles ni personne sur terre ne peuvent lui apporter l’oubli auquel il aspire en vain. Le souvenir d’Astarté, qu’il a passionnément aimée et fait périr, ronge son cœur. Il n’y a pas de limite à son désespoir.»
Le premier tableau est celui qui est le plus proche d’un mouvement de symphonie de type «musique pure» : le programme ne présente pas d’action extérieure, et le compositeur évite toute description pittoresque. La musique peut donc se concentrer sur le caractère psychologique et l’intériorité des personnages.
Dans une vaste introduction lento lugubre, le héros est représenté par deux thèmes : le premier, de caractère sombre et résolu, apparaît d’abord aux bassons et clarinette basse, suivi par le second, au profil tourmenté et à l’expression pathétique, joué aux cordes dans le grave. Il est important de bien les mémoriser puisqu’ils se retrouveront de manière cyclique dans les mouvements suivants. C’est pourquoi le compositeur les expose à trois reprises dans cette introduction, jusqu’à un énorme tutti où pèse toute la fatalité du destin tragique du héros (le fatum étant un thème privilégié des œuvres de Tchaïkovski, où il projetait sa propre angoisse existentielle, le sujet de Manfred ne pouvait que lui convenir !). Après une mesure de silence commence la partie principale du mouvement (moderato con moto) qui développe le second thème de Manfred. Une section centrale contrastante (andante) est consacrée au souvenir d’Astarté, la femme que Manfred a aimée d’un amour interdit, passionné et destructeur (le drame de Byron suggère qu’elle était la sœur de Manfred). Pendant toute cette section, où l’exaltation monte peu à peu, les cordes jouent avec sourdines, bientôt rejointes par les harpes, évoquant par leur douceur la présence lointaine de l’aimée, et son souvenir obsédant. Dans la section finale, andante con duolo (avec douleur), revient avec force le premier thème de Manfred, dans un caractère sombre, violent et tourmenté.
Deuxième tableau
«La Fée des Alpes paraît devant Manfred sous l’arc-en-ciel du torrent.»
Ce deuxième mouvement est un scherzo d’une étonnante virtuosité orchestrale, une création scintillante de gouttelettes sonores éparpillées et impalpables qui exige des musiciens d’orchestre une précision parfaite. Tchaïkovski s’est inspiré, selon le conseil de Balakirev, du «Scherzo de la Reine Mab», dans Roméo et Juliette de Berlioz, mais dépasse de loin son modèle dans le pointillisme athématique, évoquant les cascatelles irisées d’une chute d’eau. Après une longue transition apparait le thème de la Fée, mélodie gracieuse qui donne lieu à de merveilleuses variations orchestrales, proches de l’univers du ballet. Mais l’ambiance s’assombrit avec l’apparition de Manfred qui refuse l’aide de l’Esprit des Alpes (premier thème, sur un roulement de timbales). À la fin du mouvement, ce même thème, désolé, plane une dernière fois (cor anglais puis clarinette en la) au-dessus des ruissellements sonores du scherzo.
Troisième tableau
«Pastorale. Vie simple, humble et libre des montagnards.»
Dans cette pastorale, c’est encore Berlioz qui sert de référence, et plus précisément le troisième mouvement d’Harold en Italie («Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa belle»). Tchaïkovski oppose le caractère naïf d’un thème paré des timbres agrestes des bois, à l’état d’esprit tourmenté de Manfred (lyrisme passionné et désespéré), dont le premier thème apparait accompagné d’un lointain glas funèbre.
Quatrième tableau
«Le palais souterrain d’Arimane. Manfred paraît au milieu de la bacchanale. Évocation de l’ombre d’Astarté. Elle lui prédit le terme de ses maux terrestres. Mort de Manfred.»
Ce finale est le mouvement qui suit de plus près le programme, dans la succession de ses différents épisodes narratifs. Manfred se retrouve au milieu des esprits infernaux qu’il a dominés par son esprit, mais qui ont été impuissants à le soulager. Cette page d’orchestre est le pendant du «Songe d’une nuit de sabbat» de la Symphonie fantastique de Berlioz, par son évocation d’une orgie infernale aux rythmes effrénés, dans un fracas sonore fait de tournoiements et de sifflements sinistres. Une danse endiablée entraîne les protagonistes dans son tourbillon, interrompue un moment par un épisode lent et désolé où l’on reconnaît bientôt le second thème de Manfred. Mais, tout-à-coup, des accents solennels retentissent (évocation) et l’ombre d’Astarté paraît, reconnaissable au timbre voilé des cordes avec sourdines et aux frôlements surnaturels des harpes. Le premier thème de Manfred revient, passionné et douloureux, dans une exaltation sonore croissante de tout l’orchestre. Et soudain, toute dissonance est abolie : dans un glorieux choral aux sons de l’orgue (une suggestion de Balakirev), c’est l’apothéose de Manfred. Comme dans le Faust de Goethe (et contrairement au dénouement sans espoir du drame de Byron), c’est par l’intercession de l’éternel féminin que celui-ci accède enfin à la mort salvatrice à laquelle il aspirait, pendant que les basses de l’orchestre dessinent clairement le motif liturgique funèbre du Dies iræ de la messe des morts grégorienne.
– Isabelle Rouard
Pour aller plus loin
Berlioz : «La Reine Mab ou la fée des songes» (Roméo et Juliette)
Berlioz : «Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa belle» (Harold en Italie)
Berlioz : «Songe d’une nuit de Sabbat» (Symphonie fantastique)
Notre partenaire