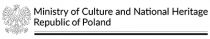◁ Retour au concert du mar. 3 fév. 2026
Programme détaillé
Trio à cordes op. 48
I. Allegro con moto
II. Andante
III. Allegro
[18 min]
I. Monodie : Allegro moderato
II. Pauses : Andantino grazioso
III. Intervalles : Presto agitato
IV. Remarques : Andantino non tanto
V. Accompagnement : Allegretto leggiero
VI. Invocation : Lento affettuoso
VII. Syncopes : Vivace marcato
[15 min]
[13 min]
--- Entracte (10 minutes) ---
I. Präludium und Arie [Prélude et Air] : Larghetto
II. Toccata : Allegro marcato
III. Poem [Poème] : Moderato
IV. Finale : Allegro moderato
[40 min]
Distribution
Linus Roth violon
José Gallardo piano
Musiciens de l’Orchestre national de Lyon :
Jean-Pascal Oswald alto
Édouard Sapey-Triomphe violoncelle
Avec le soutien du ministère de la Culture et du Patrimoine national de Pologne.
Introduction
«Le meilleur compositeur dont vous n’avez jamais entendu parler» : la boutade du présentateur à la BBC Donald Macleod à propos de Mieczysław Weinberg dit bien l’écart entre la qualité de l’œuvre du compositeur russo-polonais et la reconnaissance dont il jouit dans le monde musical – même si l’on observe ces dernières années un vrai regain d’intérêt pour sa musique, dont on peut dorénavant trouver un certain nombre d’enregistrements. Il reste cependant pour l’industrie du disque de nombreuses pages à aborder et pour le public bien des œuvres à découvrir, tant Weinberg fut un compositeur prolifique. Il a exploré toutes les formes et tous les genres musicaux, depuis la musique de film jusqu’à l’opéra, en passant par la symphonie (22 pour grand orchestre, un chiffre inégalé pour un compositeur de son époque), la musique pour voix, la sonate instrumentale ainsi que la musique de chambre. Il fut pourtant, notamment durant les premières décennies de sa vie, particulièrement malmené par l’histoire. Né à Varsovie en 1919, dans une famille endeuillée par le pogrom de 1905, il dut quitter la ville en 1939 pour échapper aux nazis, qui déportèrent et assassinèrent sa sœur et ses parents. Installé à Minsk, en Biélorussie, où il étudiait la composition, il fut à nouveau contraint de fuir face à l’avancée allemande en 1941. Il se fixa à Moscou en 1943, où il rencontra Chostakovitch. Devenus proches, les deux hommes restèrent très liés jusqu’à la mort de Chostakovitch en 1975 ; ils discutaient de musique, se montraient leurs œuvres et s’en dédicaçaient certaines. En Weinberg, Chostakovitch voyait «l’un des compositeurs les plus importants de nos jours», tandis que le cadet disait de son aîné : «Même s’il ne m’a jamais donné de leçons, je me considère comme son élève, sa chair et son sang.»
– Angèle Leroy
Les œuvres
«Le meilleur compositeur dont vous n’avez jamais entendu parler» : la boutade du présentateur à la BBC Donald Macleod à propos de Mieczysław Weinberg dit bien l’écart entre la qualité de l’œuvre du compositeur russo-polonais et la reconnaissance dont il jouit dans le monde musical – même si l’on observe ces dernières années un vrai regain d’intérêt pour sa musique, dont on peut dorénavant trouver un certain nombre d’enregistrements. Il reste cependant pour l’industrie du disque de nombreuses pages à aborder et pour le public bien des œuvres à découvrir, tant Weinberg fut un compositeur prolifique. Il a exploré toutes les formes et tous les genres musicaux, depuis la musique de film jusqu’à l’opéra, en passant par la symphonie (22 pour grand orchestre, un chiffre inégalé pour un compositeur de son époque), la musique pour voix, la sonate instrumentale ainsi que la musique de chambre. Il fut pourtant, notamment durant les premières décennies de sa vie, particulièrement malmené par l’histoire. Né à Varsovie en 1919, dans une famille endeuillée par le pogrom de 1905, il dut quitter la ville en 1939 pour échapper aux nazis, qui déportèrent et assassinèrent sa sœur et ses parents. Installé à Minsk, en Biélorussie, où il étudiait la composition, il fut à nouveau contraint de fuir face à l’avancée allemande en 1941. Il se fixa à Moscou en 1943, où il rencontra Chostakovitch. Devenus proches, les deux hommes restèrent très liés jusqu’à la mort de Chostakovitch en 1975 ; ils discutaient de musique, se montraient leurs œuvres et s’en dédicaçaient certaines. En Weinberg, Chostakovitch voyait «l’un des compositeurs les plus importants de nos jours», tandis que le cadet disait de son aîné : «Même s’il ne m’a jamais donné de leçons, je me considère comme son élève, sa chair et son sang.»
Composé peu de temps après l’installation de Weinberg à Moscou, le Trio avec piano (1945) appartient à toute une moisson d’œuvres qui utilisent le clavier, seul ou en conjugaison avec d’autres instruments. Weinberg, qui était un pianiste de premier ordre, pouvait ainsi se faire le défenseur de sa propre musique en concert. C’est donc avec le compositeur au piano, accompagné de deux des membres du Quatuor Beethoven (proches de Chostakovitch), que l’œuvre fut donnée pour la première fois. Ample, en quatre mouvements, cet extraordinaire trio conjugue les influences de Weinberg (Chostakovitch, dont le Deuxième Trio date de l’année précédente, mais aussi Prokofiev) avec un langage déjà très personnel et maîtrisé. D’une grande variété d’écriture, il représente une sorte de paroxysme expressionniste, porté par un sens du tragique acéré, visible aussi bien dans les tournures musicales que dans les lentes constructions par accumulation de tension (en particulier dans la «Toccata» et le «Poème»).
La relative liberté dont jouissaient les compositeurs dans l’immédiat après-guerre fut cruellement mise à mal dès 1948 avec la campagne «antiformaliste» jdanovienne, qui fustigeait «le refus de servir le peuple, cela au bénéfice des émotions étroitement individuelles d’un petit groupe d’esthètes élus». Weinberg, comme Chostakovitch et d’autres, tenta de trouver une voie qui apaise le pouvoir en fécondant son langage d’inspirations plus populaires. La Rhapsodie sur des thèmes moldaves, op. 47 est un hommage rendu par le compositeur à sa mère, originaire de ce qui était devenu en 1940 la République socialiste soviétique de Moldavie, où vivait une importante population juive. Cette partition parmi les plus aimées de Weinberg existe sous plusieurs formes et fut publiée à la fois pour orchestre seul et pour violon et piano. Dans une écriture très contrastée, elle présente notamment en son centre une danse virtuose d’une grande âpreté où passe le souvenir du combat de Roméo et Tybalt dans le Roméo et Juliette de Prokofiev.
Le folklore nourrit aussi le magnifique Trio à cordes op. 48 (1950), où Weinberg le marie à nouveau à ses techniques d’écriture savante (notamment la fugue, ici dans le deuxième mouvement, comme dans le finale du Trio avec piano) et son sens de la tonalité élargie. La légèreté traditionnellement associée au genre du trio à cordes est ici mâtinée d’une mélancolie et d’une gravité palpables. Il semblerait que l’œuvre n’ait pas été créée en public à l’époque de la composition, et elle est restée sous forme de manuscrit jusqu’en 2007, plus de dix ans après la mort de Weinberg. Il est certain que les temps ne se prêtaient alors pas du tout à présenter au monde une telle œuvre (à propos de laquelle Matthew Corvin parle d’une «émigration intérieure») : en 1953, au lendemain d’une interprétation de la Rhapsodie, Weinberg fut arrêté pour «nationalisme bourgeois juif». Il passa onze semaines dans la célèbre Loubianka, quartier général et prison de la police soviétique ; quand il en sortit, Staline était mort.
Les sonates pour violon solo de Weinberg, qui manifestent une expressivité radicale, datent quant à elles des décennies 1960 et 1970. À l’époque de la composition des deux premières, Weinberg était occupé à écrire son opéra Le Passager, souvenir de l’Holocauste dans lequel Tadeusz, exécuté pour avoir joué la «Chaconne» de la Partita n° 2 de Bach, représente en quelque sorte son double de fiction. En 1966, l’année précédant la Sonate n° 2, le compositeur découvrit enfin ce qui est arrivé à sa sœur et ses parents durant la guerre. C’est tout cet arrière-plan de solitude et de questionnements sur l’humanité qui irrigue une œuvre écrite pour un violon véritablement à nu. Suite de sept mouvements indépendants, elle juxtapose des pièces de caractère dans un idiome exploratoire tant au niveau du langage tonal que des modes de jeu. La Sonate op. 95 est un rejeton lointain des pièces pour violon solo de Bach marqué par la perte de l’innocence.
– Angèle Leroy
Polska
Amie séculaire de la France, la Pologne se distingue par une richesse musicale extraordinaire et une scène artistique foisonnante. La saison 2025/2026 de l’Auditorium met en lumière ces trésors, offrant une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les œuvres de compositeurs tels que Szymanowski, Lutosławski, Bacewicz, Szpilman, Zarębski, Kurpiński, Weinberg, Tansman et bien sûr Chopin. Des artistes polonais de renom – Marta Gardolińska, Karol Mossakowski, l’ensemble Arte dei Suonatori, le Quatuor Equilibrium, entre autres – nous honorent par ailleurs de leur présence à Lyon, apportant leur talent pour enrichir ce fil rouge artistique aussi captivant qu'original.