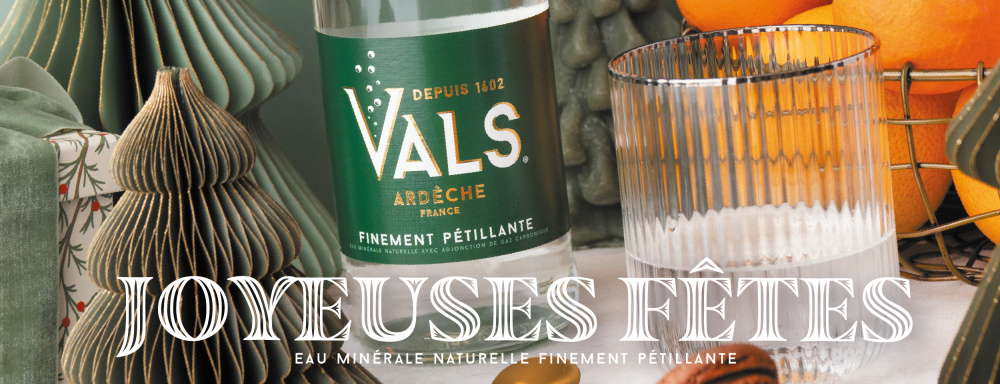◁ Retour au concert du mar. 9 déc. 2025
Programme détaillé
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746)
Prélude et Fugue en mi majeur, extrait d’Ariadne Musica
Johann Joseph Fux (c. 1669-1741)
Fugue extraite du Gradus ad Parnassum
Johann Caspar Ferdinand Fischer
Prélude et Fugue en do dièse mineur, extrait d’Ariadne Musica
Louis Couperin (c. 1626-1661)
Pavane en fa dièse mineur
Johann Caspar Ferdinand Fischer
Prélude et Fugue en ré majeur, extrait d’Ariadne Musica
Johann Jakob Froberger (1616-1667)
Ricercare n° 4
Johann Caspar Ferdinand Fischer
Prélude et Fugue en la majeur, extrait d’Ariadne Musica
Johann Jakob Froberger
Méditation sur ma mort future
Johann Jakob Froberger
Fantasia n° 2
--- Entracte ---
Andreas Staier (né en 1955)
Anklänge (six pièces pour clavecin)
I. Tempo flessibile [Tempo souple]
II. Largo [Large]
III. Con forza [Avec force]
IV. Un poco più lento del Preludio BWV 878/1 [Un peu plus lent que le Prélude BWV 878/1]
V Sempre legatissimo [Toujours très lié]
VI. Esitando [En hésitant]
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prélude et Fugue en mi majeur, BWV 878 (Le Clavier bien tempéré, livre II)
Durée : 1h20 + entracte (10 min).
Distribution
Andreas Staier clavecin
Stephen Sazio médiation
Introduction
Comme tout interprète de premier plan, Andreas Staier enregistre les monuments du répertoire de son instrument : Le Clavier bien tempéré et les Variations Goldberg de Bach, les Variations Diabelli de Beethoven. Mais il aime aussi explorer un lieu riche d’histoire : l’album Hamburg 1734 (Harmonia Mundi, 2005) mêle ainsi Telemann, Händel, Böhm, Mattheson, auxquels s’ajoutent des transcriptions réalisées par Staier et une pièce contemporaine de Brice Pauset. Pour passer la mélancolie (Harmonia Mundi, 2012) décline les mille nuances d’un état d’âme qui inspira notamment Johann Caspar Ferdinand Fischer, Louis Couperin et Johann Jakob Froberger, de nouveau présents dans le disque Méditation (Alpha, 2022). Avec ce récital, Staier invite à découvrir les affinités entre des compositeurs qui, pour la plupart, ne se sont jamais rencontrés. Souvent synonyme de «contemplation», le mot «méditation» doit ici s’appréhender comme une profonde réflexion, suscitée par deux brefs motifs dont Andreas Staier observe la récurrence dans les pièces qu’il a sélectionnées. Le premier (sol-la-do-si-la-sol) s’entend dans l’hymne Pange lingua (XIIIe siècle), chantée à la fête du Saint-Sacrement et attribuée à saint Thomas d’Aquin. De façon plus générale, il s’agit d’une tournure mélodique fréquente dans la modalité médiévale, que Froberger utilise comme fondement de son Ricercare n° 4 et, avec un autre agencement des tons et demi-tons (si-do-mi-ré-do-si), de sa Fantaisie n° 2. Staier souligne que dans le Gradus ad Parnassum de Fux, ce motif fait l’objet d’un grand nombre d’élaborations contrapuntiques. Transposé sur les notes mi-fa dièse-la-sol dièse-fa dièse-mi, il constitue également le sujet des fugues en mi majeur de Fischer et de Bach.
– Hélène Cao
Le ricercare
Également orthographié ricercar, recercar, recercada ou recercata, ce mot signifie «rechercher». Il est utilisé à la Renaissance et au début du Baroque, surtout en Italie, pour désigner des pièces instrumentales qui ne se distinguent pas toujours du prélude, de la fantaisie ou de la toccata, tant les frontières sont poreuses entre les genres.
Il existe plusieurs catégories de ricercare. Dans la première, généralement consignée dans des traités, il s’agit de morceaux constitués de gammes et de lignes essentiellement conjointes, donnant une sensation d’improvisation : ils fournissent des modèles à l’instrumentiste pour improviser un prélude ou orner une mélodie. La deuxième catégorie de ricercare se caractérise par une écriture polyphonique fondée sur des entrées en imitation. Dès lors, il ouvre la voie à la fugue. Rare après le XVIIe siècle, il reparaît cependant chez Bach, qui utilise le terme pour désigner les deux fugues de son Musikalisches Opfer [L’Offrande musicale] (1747).
La fantaisie
Dès sa naissance au XVIe siècle, la fantaisie est associée à l’imprévisibilité et à l’esprit d’improvisation (phantasia en grec : «apparition»). Elle ne désigne ni une forme, ni une technique compositionnelle précise. Surtout destinée au luth et au clavier (même si les Français et les Anglais pratiquent aussi la fantaisie pour violes), elle se confond avec le prélude, le capriccio et le ricercare. Elle peut contenir des sections contrapuntiques, des sections fondées sur des enchaînements d’accords, ou des formules de gammes et d’arpèges souvent virtuoses donnant l’impression d’une improvisation.
Autre fil conducteur
Autre fil conducteur : l’enchaînement la-mi-fa dièse-do dièse qui, remarque Staier, «est omniprésent dans la musique occidentale, depuis le début de l’ère baroque au moins». Trois pièces de son programme en sont l’illustration : le Prélude en la majeur de Fischer, dans lequel les voix entrent l’une après l’autre sur ce motif ; la Pavane en fa dièse mineur de Couperin et la Méditation sur ma mort future de Froberger, lequel transpose souvent la formule sur d’autres notes. Si ces deux dernières pièces saisissent par leur densité expressive – qui, dans le cas de Froberger, se double d’une troublante projection autobiographique –, le motif n’a toutefois rien de funèbre : ce sont encore sur ses notes que sonneront les cloches de Parsifal, le dernier opéra de Wagner (1882).
Si le clavecin connaît son âge d’or à l’époque baroque, Staier ne s’est jamais limité à cette période (sa pratique du pianoforte et du piano moderne lui permet d’ailleurs d’élargir le champ). Sa collaboration avec Brice Pauset, dont il crée la Kontra-Sonate (conçue comme un prologue et un épilogue à la Sonate pour piano en la mineur D. 845 de Schubert), et ses conversations avec la compositrice allemande Isabel Mundry, l’ont amené à réfléchir à l’acte compositionnel, notamment lorsqu’il s’agit d’écrire pour instruments anciens. Jetant sur le papier nombre d’esquisses pendant son temps libre, il les abandonne cependant dès que reprend son intense activité d’interprète. Mais en 2020, la pandémie lui permet de s’adonner à la composition et d’achever Anklänge.
Ce terme, que l’on peut traduire par «Échos», induit l’idée de rappeler, de laisser transparaître. Les souvenirs qui affleurent ici sont le motif de Pange lingua et celui des «cloches de Parsifal», car ils innervent les six accords qui servent de matrice au cycle. Le compositeur-claveciniste explique que «le thème complet de Pange lingua, dans des transpositions à chaque fois différentes, est contenu dans le premier, le troisième et le sixième accords, ses trois premières notes formant pour ainsi dire le plus grand commun dénominateur des six accords», tandis que «le ‘‘motif de Parsifal’’ est compris dans le sixième accord». Ces formules mélodiques, à l’origine indépendantes, sont mises en relation de façon à créer des «constellations». Comme dans les pièces baroques du programme, elles font l’objet d’un travail contrapuntique rigoureux, reposant en particulier sur le procédé du canon. Mais, à l’exception de la quatrième pièce, d’où émergent fugitivement des souvenirs du prélude de Bach, ces manipulations ne s’entendent guère. Enraciné dans un langage non tonal, Anklänge dialogue avec l’époque baroque, mais sans jamais la pasticher. À la fin de la dernière pièce, Staier demande d’enchaîner sans interruption avec le Prélude et Fugue en mi majeur du Premier Livre du Clavier bien tempéré : un geste qui rend hommage à Bach et aux musiciens qui l’ont précédé, puisque leur sève nourrit sa propre création.
– H. C.
Notre partenaire