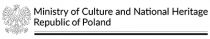◁ Retour au concert du lun. 3 nov. 2025
Programme détaillé
Suite pour orchestre n° 3, en ré majeur, BWV 1068
Version pour cordes et continuo
I. Ouverture
II. Air
III. Gavotte I – Gavotte II – Gavotte I da capo
IV. Bourrée
V. Gigue
[18 min]
Concerto pour viole de gambe et cordes en ré mineur, GraunWV A:XVIII:4
I. Allegro non tanto
II. Largho [sic]
III. Allegro
[20 min]
Concerto polonais en sol majeur, TWV 43:G7
I. Dolce
II. Allegro
III. Largo
IV. Allegro
[9 min]
Concerto pour clavecin et orchestre à cordes en ré mineur, DürG 16
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro di molto
[33 min]
Distribution
Arte dei Suonatori
Marcin Świątkiewicz clavecin et direction
Krzysztof Firlus viole de gambe
Avec le soutien du ministère de la Culture et du Patrimoine national de Pologne.
Introduction
De 1705 à 1712, Georg Philipp Telemann fut Kapellmeister à la cour du comte Erdmann II von Promnitz, à Sorau, en Silésie (aujourd’hui Żary, en Pologne). Il put apprécier la «beauté authentique et barbare» de la musique polonaise et morave jouée à Cracovie. C’est pourquoi son catalogue recèle de nombreuses danses, certaines probablement notées sur place dans les tavernes, ainsi que des quatuors et sonates qualifiés de «polonais», dont le Concerto en sol majeur est le plus célèbre. Mais parce que la musique polonaise s’est en retour enrichie au contact des esthétiques germaniques, l’ensemble Arte dei Suonatori regarde lui aussi vers l’ouest. C’est l’occasion de redécouvrir la Troisième Suite de Bach sous sa forme pour cordes seules, celle qu’aurait voulue à l’origine le compositeur, et de se laisser emporter par la virtuosité de deux concertos. Le Concerto pour viole de gambe en ré mineur de Johann Gottlieb Graun est une redécouverte : longtemps attribué à un compositeur anonyme, il a désormais retrouvé avec certitude son auteur. Quant à Johann Gottlieb Goldberg, il n’est autre que ce brillantissime élève de Bach qui aurait adouci les nuits de son employeur insomniaque en lui jouant les variations de son maître, lesquelles prirent ensuite son nom. Il était temps de rendre justice au travers de ses propres œuvres à ce musicien foudroyé par la tuberculose à 29 ans.
Texte : Auditorium-Orchestre national de Lyon
Les œuvres
Élaborée progressivement au cours du XVIe siècle, la suite de danses devint, au XVIIe siècle, un des genres instrumentaux majeurs de la musique baroque. À partir de Johann Jacob Froberger (1616-1667), elle s’établit ainsi dans un canon relativement stable : quatre danses principales – allemande, courante, sarabande, gigue – précédées d’un prélude, auxquelles s’adjoignent d’autres danses et pièces de facture plus légère (menuet, gavotte, bourrée, etc.).
Johann Sebastian Bach (1685-1750) composa de nombreuses suites pour toutes les formations instrumentales, depuis les pièces solistes jusqu’aux suites pour orchestre, à l’image des quatre Suites pour orchestre BWV 1066 à 1069. Imaginées indépendamment les unes des autres, elles ont été composées d’abord au cours du séjour de Bach à Cöthen (1717-1723) puis complétées à Leipzig, vraisemblablement en vue des concerts du Collegium Musicum dont il fut directeur de 1729 à 1737.
Chacune des quatre suites s’ouvre sur une ouverture inspirée des ouvertures à la française de Lully : une première partie majestueuse, en homorythmie, caractérisée par des rythmes surpointés conférant à l’ensemble une grande solennité, alternant avec une partie plus vive, fuguée, portée par des solos. D'une orchestration particulièrement brillante (trois trompettes, deux hautbois, timbales, cordes et continuo), la Suite pour orchestre n° 3 s’ouvre ainsi sur une première partie à deux temps monumentale, dominée par les trompettes et hautbois qui colorent de teintes éclatantes un thème énoncé par l’ensemble de l’orchestre ; une seconde partie enlevée, marquée de longs solos virtuoses de violon, vient compléter en alternance le premier matériau orchestral.
S’écartant du canon aménagé par Froberger, Bach compose en place d’allemande son célèbre «Air» pour violon concertant, animé de longues dissonances s’étirant entre chant, contrechants et basse. Lui succèdent une énergique «Gavotte et son double», dans laquelle les trompettes reprennent la première place, une rapide «Bourrée» aux accents décalés, avant une «Gigue» finale, d’une redoutable difficulté pour les trompettes, qui renoue avec la pompe déployée dans l’«Ouverture».
Né du concerto grosso, le concerto de soliste apparaît dans les dernières années du XVIIe siècle, d’abord en Italie, avant d’essaimer dans toute l’Europe. Structuré en trois mouvements vif / lent / vif, le genre joue sur les oppositions de couleurs instrumentales (alternance de passages solistes et de tuttis d’orchestre) comme sur le déploiement de longs passages de virtuosité mettant en valeur les qualités techniques et expressives d’un soliste. À l’origine issu des rangs de l’orchestre, comme dans le concerto grosso, ce soliste est progressivement remplacé par un virtuose renommé, spécialement invité pour exécuter l’œuvre : c’est le cas dans le Concerto pour viole de gambe et cordes en ré mineur GraunWV A:XVIII:4 de Johann Gottlieb Graun, puisque la viole n’est plus un instrument constitutif de l’orchestre en Allemagne au XVIIIe siècle.
Violoniste virtuose, élève de Giuseppe Tartini à Padoue, Johann Gottlieb Graun (c. 1702-1771) passa la plus grande partie de sa carrière au service de Frédéric II de Prusse, tout comme son frère Carl Heinrich Graun (1703/4-1759). Attaché à la maison du prince héritier depuis 1732, premier violon de l’orchestre du nouvel Opéra de Berlin depuis l’avènement du souverain au pouvoir en 1740, Johann Gottlieb composa essentiellement de la musique instrumentale (sonates, symphonies, concertos), dans l’ombre de son frère chargé de la composition des opéras de la cour. C’était pourtant un musicien de très grande qualité : Johann Sebastian Bach l’avait d’ailleurs chargé d’enseigner le violon à son jeune fils Wilhelm Friedemann (1710-1784), et invité à se produire lors de concerts du Collegium Musicum.
Le Concerto en ré mineur témoigne de sa grande maîtrise du genre comme d’une habitude de la virtuosité instrumentale héritée de Giuseppe Tartini (1692-1770). Dans le premier mouvement, à trois temps, Allegro ma non tanto, un thème étonnamment simple (un fragment de gamme ascendante articulé dans un rythme incisif) circule entre la viole de gambe et l’orchestre, sans cesse remodelé tant par le contexte tonal (transpositions) que par toutes sortes de procédés de variation qui en changent la couleur et le caractère : transformations rythmiques, monnayages (divisions des valeurs rythmiques en plusieurs valeurs plus petites) par l’ajout de bariolages (passages d’une corde à l’autre) véloces, élargissement de son ambitus par l’exploration de toute l’étendue sonore de la viole, jusqu’aux aigus les plus virtuoses, épaississement de sa texture par l’ajout de doubles cordes et d’accords. Le deuxième mouvement, Largo, émaillé de nombreuses appogiatures expressives, de mélodies en tierces parallèles et d’ornements, évoque le style galant du premier classicisme. En contraste, le troisième et dernier mouvement, Allegro, retrouve la vigueur rythmique du premier, marqué d’accents et de constants changements de nuances lui conférant le caractère d’une brillante danse populaire.
En quatre mouvements lent / vif / lent / vif, le bref Concerto polonais en sol majeur TWV 43:G7 de Georg Philipp Telemann (1681-1767) épouse les caractéristiques du concerto grosso de chambre. Structurés en deux parties répétées, ses premier et troisième mouvements évoquent les danses de la suite de danses sur laquelle se modèle le concerto grosso, tandis que les deuxième et quatrième mouvements, par leur accentuation marquée, leurs passages sur bourdons et leurs ornements joyeux adoptent un caractère résolument populaire. Marquée par un style homophone et mue par un parcours tonal simple et de nombreuses marches harmoniques, l’œuvre semble annoncer l’école de Mannheim, d’où naît la symphonie classique.
En contraste, le Concerto pour clavecin en ré mineur de Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756) est profondément marqué par l’empreinte du dernier baroque – omniprésence du contrepoint, densité harmonique d’un langage marqué de nombreuses dissonances (retards, fausses relations, pédales harmoniques) : son style n’évoque que peu les évolutions stylistiques en cours au mitan du XVIIIe siècle.
Grand virtuose du clavecin et de l’orgue mort précocement, compositeur d’un catalogue d’œuvres restreint, Goldberg fut l’élève de Jean-Sébastien puis de Wilhelm Friedemann Bach – son image reste à jamais associée dans l’histoire de la musique aux célèbres variations nommées en son honneur. Son Concerto pour clavecin en ré mineur compte parmi les rares œuvres que l’on connaisse de lui aujourd’hui.
Le premier mouvement, Allegro, rappelle, par sa densité harmonique et la volubilité des traits du clavecin soliste, le travail de Jean-Sébastien Bach dans ses propres concertos ; le second mouvement, Largo, déploie de constantes modulations colorées de nombreux retards, avant un dernier Allegro di molto très vivaldien par son énergie rythmique et sa vélocité.
– Coline Miallier
Polska
Amie séculaire de la France, la Pologne se distingue par une richesse musicale extraordinaire et une scène artistique foisonnante. La saison 2025/2026 de l’Auditorium met en lumière ces trésors, offrant une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les œuvres de compositeurs tels que Szymanowski, Lutosławski, Bacewicz, Szpilman, Zarębski, Kurpiński, Weinberg, Tansman et bien sûr Chopin. Des artistes polonais de renom – Marta Gardolińska, Karol Mossakowski, l’ensemble Arte dei Suonatori, le Quatuor Equilibrium, entre autres – nous honorent par ailleurs de leur présence à Lyon, apportant leur talent pour enrichir ce fil rouge artistique aussi captivant qu'original.