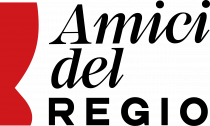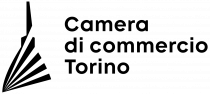◁ Retour au concert du sam. 25 oct. 2025
Programme détaillé
Capriccio sinfonico
[12 min]
Francesca da Rimini, fantaisie symphonique d’après Dante, op. 32
[25 min]
--- Entracte ---
Macbeth
– Chœur des sorcières «Che faceste ? Dite su !»
– Chœur des sicaires «Chi v’impose unirvi a noi ?»
– Ballet
– Chœur des réfugiés écossais « Patria oppressa»
[22 min]
[Les Brigands]
Prélude
[5 min]
[Les Lombards à la Première Croisade]
Chœur des croisés et des pèlerins «O Signore, dal tetto natio»
[4 min]
– Ouverture
– Chœur d’introduction «Gli arredi festivi»
[15 min]
Avec le soutien de l’Association des Amis du Regio et de la Chambre de commerce de Turin.
En partenariat avec Culture Relax.
Cette représentation est un concert Relax.
Relax permet le partage des lieux culturels dans une atmosphère accueillante et détendue, facilitant la venue de personnes dont le handicap peut parfois entraîner des comportements atypiques pendant la représentation.
Distribution
Orchestre et Chœur du Teatro Regio Torino
Andrea Battistoni direction
Ulisse Trabacchin chef de chœur
Introduction
Comme l’Auditorium de Lyon, le Teatro Regio Torino (Théâtre royal de Turin) vient de fêter ses 50 ans, rebâti entièrement – derrière sa façade baroque – après un incendie dévastateur. Des lustres et des formes géométriques de l’entrée à la vaste salle en théâtre romain, sous son toit en béton armé, le mélomane lyonnais s’y sent en terrain familier. Là s’arrête la comparaison car, au Regio, c’est l’art lyrique qui est célébré. Sous la direction d’Andrea Battistoni, directeur musical, son orchestre et son chœur comptent parmi les meilleurs d’Italie. C’est parés de cette réputation qu’ils interprètent les grandes pages chorales et symphoniques des deux premiers grands succès de Verdi, Nabucco (1842) et I lombardi alla prima crociata (Les Lombards à la Première Croisade, 1843), et de deux partitions plus tardives (1847) qui marquent l’éloignement des sujets patriotiques au profit de drames intimes : Macbeth, inspiré par une pièce de William Shakespeare, et I masnadieri [Les Brigands], d’après le premier drame de Friedrich Schiller. En première partie, le Capriccio sinfonico composé par le jeune Puccini pour son examen final au Conservatoire de Milan (1883) précède la «fantaisie symphonique» de Tchaïkovski Francesca da Rimini (1876), qui illustre une tragique histoire d’amour contée dans L’Enfer de Dante.
Texte : Auditorium-Orchestre national de Lyon
Puccini, Capriccio sinfonico
Composition : 1883.
Révision : 1893.
Création : Milan, Conservatoire royal, 14 juillet 1883, par l’orchestre du Conservatoire sous la direction de Franco Faccio.
Seconde partition publiée par Puccini, le Capriccio sinfonico [Caprice symphonique] vient couronner trois années d’études au Conservatoire royal de Milan, où le jeune musicien toscan a été l’élève d’Amilcare Ponchielli, l’auteur de l’opéra La Gioconda. Sa première audition est dirigée par une des baguettes les plus éminentes du moment : le chef d’orchestre de la Scala, Franco Faccio, qui a assuré – entre autres – les créations mondiales ou italiennes de plusieurs opéras de Verdi.
Une autre bonne fée se penche sur le berceau de l’œuvre : l’influent critique musical Filippo Filippi, qui écrit dans La perseveranza : «Puccini possède un tempérament musical résolu et très rare, en particulier en tant que symphoniste. Unité de style, personnalité, caractère : son Capriccio sinfonico regorge de tout cela, à un degré que l’on trouve chez peu d’autres compositeurs, même les plus expérimentés [...]. Il n’y a ni incertitudes, ni tergiversations, et le jeune auteur, une fois lancé, ne se perd pas, ne s’écarte pas du chemin tracé. Les idées sont claires, solides, très efficaces, soutenues par beaucoup de vérité, de hardiesse harmonique.»
L’écho de cette réussite circule dans les cercles musicaux milanais, et même Verdi, qui a désormais soixante-dix ans, voit sa curiosité éveillée par ce jeune musicien qui, alors, semble plus prometteur dans le domaine de la symphonie que dans celui de l’opéra – une impression qui sera vite balayée.
Puccini a mis beaucoup d’énergie dans cette pièce qu’il a retouchée jusqu’aux répétitions. Après la création, Faccio la reprend à Milan, puis deux fois Turin. Le Capriccio sinfonico est révisé en 1893 et joué sous cette forme à Venise. Il tombe ensuite dans l’oubli. Mais il continue de vivre au travers d’opéras où Puccini reprend certains de ses éléments.
L’œuvre est construite en deux volets. Le premier, assez dramatique et de tempo lent (Andante moderato), reparaîtra dans la marche funèbre de l’acte III de l’opéra Edgar (créé à la Scala en 1889). Le second est plus vif (Allegro vivace). Son motif sera repris au début de La Bohème (créé au Teatro Regio de Turin en 1896). Le thème initial revient ensuite, avant une conclusion en douceur.
– Claire Delamarche
Tchaïkovski, Francesca da Rimini
Composition : octobre-novembre 1876.
Création : Moscou, 25 février 1877, sous la direction de Nikolaï Rubinstein.
Dédicace : à Sergueï Taneïev.
Peu de temps après avoir composé la musique de son célèbre ballet Le Lac des cygnes (achevé en avril 1876), Tchaïkovski se mit en quête d’un nouveau sujet d’inspiration littéraire pour un poème symphonique. Son frère Modest lui proposa Othello, Hamlet, ainsi qu’un épisode tiré de la Divine Comédie de Dante, Francesca da Rimini. Ayant déjà illustré symphoniquement Shakespeare (avec Roméo et Juliette et La Tempête), Tchaïkovski choisit cette fois l’épisode romantique des amants damnés qui est narré dans le chant V de L’Enfer : le poète, guidé par l’ombre de Virgile, descend les différents cercles de l’abîme infernal, un ouragan tourbillonnant qui résonne des cris et gémissements des damnés. Au deuxième cercle se trouvent les âmes qui ont succombé aux tentations charnelles, parmi lesquelles le poète remarque les ombres douloureusement enlacées de Francesca et Paolo. Dante appelle Francesca et lui demande de lui raconter ce qui a causé son terrible châtiment. En larmes, elle raconte la triste histoire de son amour pour Paolo, le frère de son époux légitime (un tyran borgne et bossu à qui elle a été mariée contre son gré). Un simple baiser échangé fut la cause de leur chute, et le mari qui les surprit les poignarda sauvagement.
À titre personnel, Tchaïkovski semble avoir été particulièrement touché par les histoires tragiques d’amour impossible comme celle-ci, lui qui se sentait toujours poursuivi par le fatum, un destin pesant et implacable. Il fut inspiré également par la contemplation des célèbres gravures de Gustave Doré dans l’édition de la Divine Comédie parue en 1861, dont un motif est d’ailleurs reproduit sur la page de titre de la partition. Ces scènes d’une puissante expression fantastique l’aidèrent à concevoir une musique d’un caractère visionnaire et incandescent.
Une autre influence se laisse percevoir dans cette puissante page d’orchestre : peu de temps avant sa composition, Tchaïkovski se rendit à Bayreuth, invité pour l’inauguration en août 1876 du Festspielhaus construit par Wagner pour la représentation de ses propres œuvres. Il devait rendre compte, pour un journal russe, du tout premier festival, où avait lieu la première exécution intégrale de la Tétralogie. Dans les cinq articles qu’il rédigea, il exprime de sérieuses réserves sur l’esthétique dramatique et musicale wagnérienne, et dans ses lettres privées, il est encore plus clair, jugeant le cycle «assommant et interminable», critiquant «l’accumulation d’harmonies les plus compliquées» et «le manque de coloris» de l’expression vocale. Pourtant il semble s’être laissé entraîner à une certaine fascination pour les couleurs orchestrales et le langage chromatique wagnérien, qui transparaît dans Francesca da Rimini : l’orchestre y est particulièrement puissant, chargé en sonorités cuivrées (avec quatre cors, deux trompettes, deux cornets à pistons, trois trombones et un tuba). En outre, dans l’introduction et la première grande partie, le discours ne comporte que des harmonies dissonantes, dans un contexte tonal incertain et fuyant, et s’enroule sur des vastes périodes par volutes infinies, sans le moindre repos consonant.
Le déroulement de l’œuvre suit de près le programme : tout d’abord, une introduction pesante et lugubre plante le décor, puis l’action s’anime : des gémissements torturés s’élèvent de l’orchestre. Après une brève interruption où reparaissent les accords menaçants du début, une tempête infernale de déchaîne, en tourbillonnements vertigineux, d’où émerge un thème héroïque. Après un second rappel des accords menaçants, la partie centrale évoque le récit désolé de Francesca. Il s’agit d’une véritable scène lyrique, où la clarinette solo est la voix de l’héroïne et les cordes aux sonorités voilées (avec sourdines) chantent un thème d’amour, de plus en plus exalté. Ce passage, qui ne doit plus rien à Wagner, a été critiqué en son temps : on y a vu une couleur russe, hors de propos dans cette œuvre ancrée dans la culture méditerranéenne. Mais quand Tchaïkovski évoque l’amour, il ne peut que parler sa langue natale ! Peu à peu l’ambiance se tend, lourde de menaces, jusqu’à la catastrophe ; les amants sont alors précipités dans la mort et la damnation, scellées par un lugubre choral de trombones, instruments à la symbolique funèbre. Respectant la disposition du cercle infernal, Tchaïkovski reprend alors symétriquement le tourbillon tempétueux qui précédait la scène lyrique centrale, jusqu’à un paroxysme de puissance dévastatrice.
– Isabelle Rouard
Verdi, ouvertures et chœurs
Le 6 mars 1842, lorsque Nabucodonosor – plus connu sous son diminutif Nabucco – est présenté à la Scala de Milan, bien rares sont ceux qui auraient parié sur un pareil triomphe. Après un premier drame prometteur, Oberto, conte di San Bonifacio (Oberto, comte de San Bonifacio, 1839), Verdi s’est en effet fourvoyé dans un opéra bouffe, Un giorno di regno (Un jour de règne, 1840), écrit sous le coup d’une tragédie personnelle : le compositeur avait perdu en quelques mois sa première épouse et ses deux enfants. Le titre était tristement prémonitoire puisque l’œuvre ne tint qu’un soir.
Le succès de Nabucco attisera la convoitise des directeurs de théâtre, désireux de récolter eux aussi quelques éclats de cette gloire naissante. Les commandes vont se bousculer. Dans ces ouvrages, il saura flatter la fibre patriotique de l’Italie du Risorgimento, dont les idées correspondent à sa propre sensibilité. Jusqu’à l’échec de la révolution de 1848-1849, ses opéras laisseront une large part aux sujets politiques.
Au sein de ces ouvrages, les chœurs font vibrer les auditoires : ils ont tôt fait de s’identifier aux Hébreux opprimés de Nabucco, aux Lombards exilés de I lombardi alla prima crociata (Les Lombards à la Première Croisade, 1843) ou aux réfugiés écossais de Macbeth (1847). Le peuple, qui se cherche un hymne national, se laisse prendre aux rets de ces musiques entêtantes, que Verdi a parées de la plus grande simplicité : des mélodies aisément mémorisables et des accompagnements simples qui leur sont tout dévoués. Les chœurs du jeune Verdi privilégient l’unisson – le peuple italien parle d’une seule voix –, qu’ils débordent de puissance ou murmurent douloureusement.
Dans le chœur introductif de Nabucco «Gli arredi festivi già cadono infranti» [«Les décorations de fête tombent déjà en lambeaux»], Hébreux, Lévites et Vierges pleurent le sort de leur patrie, vaincue par le roi assyrien Nabuchodonosor. La grandeur tragique de la strophe initiale – avec tous les poncifs des musiques de tempête : vagues houleuses, gammes véloces, septièmes diminuées –, la solennité de celle dévolue aux Lévites, la douceur de celle des Vierges, et enfin la superposition habile de ces différents univers dans la strophe finale font de ce chœur l’un des plus aboutis du jeune Verdi.
C’est à l’acte III que figure la page la plus célèbre, peut-être, de toute son œuvre : le chœur des Hébreux réduits en esclavage «Va’, pensiero sull’ali dorate», libre adaptation du Psaume 137 («Sur les rives de Babylone…»). Cette sorte de grande aria chorale sera aussitôt adoptée par les patriotes italiens. Le «Chœur des esclaves» ne figure pas au programme de ce concert. On peut néanmoins l’entendre dans une version un peu remaniée (avec un rythme ternaire) au sein de la sinfonia (ouverture) de l’opéra, où Verdi offre un pot-pourri de quelques mélodies à venir. Dans ce morceau purement orchestral, on reconnaît aussi l’angoissé thème en staccato (notes très brèves séparées les unes des autres) du chœur «Il maledetto», où les Hébreux maudissent Ismaele, le neveu et héritier de leur roi, qui est tombé amoureux de Fenena, la fille de leur ennemi et bourreau, Nabucco.
Composé sur la vague du triomphe de Nabucco et créé comme lui à la Scala, I lombardi reçut un accueil tout aussi retentissant. Sur la scène de la capitale lombarde, l’ouvrage offrait des possibilités identificatoires encore accrues : les Lombards assoiffés dans le désert de Palestine, c’était évidemment eux-mêmes, qui se trouvaient alors sous une domination autrichienne haïe. Dans cet imbroglio de vengeances familiales, de luttes religieuses et d’amours contrariées, le chœur «O Signore, dal tetto natio» [«Ô Seigneur, du toit natal»] est comme «Va’, pensiero» une prière doublée d’une poignante évocation de la terre natale. Il recèle en son milieu une délicieuse évocation des «ruisselets des prés lombards».
À la suite d’Attila (1846), Verdi effectue un virage stylistique radical. Il renonce à la force du groupe pour la fragilité de l’individu, préfère désormais les émotions aux idéaux, et cela s’accompagne de profondes mutations stylistiques. Cette nouvelle manière, qui culminera dans la célèbre trilogie de 1851-1853 (Il trovatore, Rigoletto, La traviata), est inaugurée par Macbeth, présenté à Florence en mars 1847. Verdi s’y appuie sur le dramaturge qu’il admire par-dessus tout : William Shakespeare. La politique passe en arrière-plan, et l’action explore le couple diabolique formé par Macbeth et sa femme.
Pour renforcer l’étrangeté et la noirceur du drame, Verdi recourt à des éléments surnaturels, notamment des chœurs de sorcières comme le chœur «Che faceste ? Dite su !», au lever de rideau. Les sorcières devisent autour de leurs chaudrons. Juste après, elles révéleront à Macbeth son avenir royal, le poussant sur la voie des assassinats qui lui assureront le trône d’Écosse. La première victime est Banco, tué par des sicaires que l’ont voit préparer le meurtre dans le chœur «Chi v’impose unirvi a noi ?» [«Qui vous a ordonné de vous unir à nous ?»]. Trois groupes se rejoignent et, lorsqu’ils commencent à chanter ensemble, ils ne sont accompagnés que de la timbale. Cet effet très original s’ajoute au chant staccato et aux contrastes marqués pour brosser une atmosphère angoissante.
En 1865, Verdi remanie Macbeth pour le Théâtre lyrique, scène parisienne plus modeste mais aussi moins rigide que l’Opéra. Pour répondre aux exigences de Paris, Verdi insère un superbe ballet à l’acte III. Sorcières, esprits et diables dansent une vive bacchanale. Puis des éclairs et coups de tonnerre annoncent l’apparition d’Hécate, déesse de la nuit et des sortilèges, qui est symbolisée par un beau duo de basson et clarinette basse. Sorcières et déesse conversent, décidant qu’il faut à présent mettre Macbeth devant son destin.
À l’acte IV, dans la version parisienne, Verdi supprime également le chœur «Scozia oppressa» [«Écosse opprimée»], un chant à l’unisson qui se situait dans la lignée de «Va’, pensiero» ou «O Signore dal tetto natio». Il le remplace par un chœur beaucoup plus riche dans sa texture, son accompagnement et son harmonie : «Ô patrie», qui deviendra dans la traduction italienne créée à la Scala de Milan en 1874 «Patria oppressa» [«Patrie opprimée»].
Premier ouvrage que Verdi compose pour l’étranger, I masnadieri (Les Brigands, 1847) témoigne de l’aura internationale qu’il a désormais acquise. La commande vient de la principale scène de Londres, Her Majesty’s Theatre, et la proposition financière dépasse toutes celles qu’il a eues jusqu’alors. La vedette sera Jenny Lind, le «Rossignol suédois», pour qui Verdi compose un rôle plus virtuose qu’à son habitude, renouant avec le style de Donizetti. L’ouvrage est inspiré du premier drame de l’écrivain allemand Friedrich Schiller, Die Räuber (Les Brigands, 1782). Un jeune homme, déshérité par suite des manigances de son frère cadet, rejoint une bande de brigands et sauve de la mort son vieux père injustement emprisonné. Mais, alors qu’il semble avoir retrouvé son rang, les brigands lui rappellent le serment de fidélité qu’il leur a fait ; il préfère poignarder sa bien-aimée plutôt que de devoir l’abandonner. Le prélude déploie un émouvant solo taillé sur mesure pour le violoncelle solo italien de Her Majesty’s, Alfredo Piatti, que Verdi avait connu durant ses études à Milan.
– C. D.