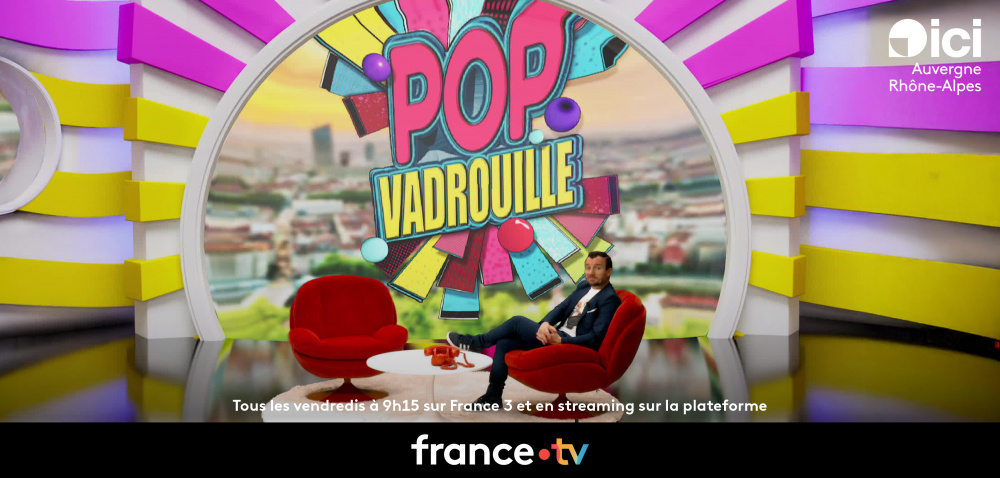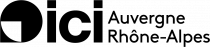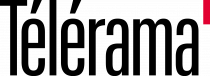◁ Retour aux concerts des jeu. 18 déc. et sam. 20 déc. 2025
Programme détaillé
Poème de l’amour et de la mer, op. 19
I. La Fleur des eaux
Interlude
II. La Mort de l’amour
[30 min]
--- Entracte ---
Pulcinella, ballet avec chant en un acte d’après Giambattista Pergolesi
I. Ouverture : Allegro moderato
II. Serenata : Larghetto, «Mentre l’erbetta pasce l’agnella» (ténor)
III. Scherzino : Allegro
IV. Poco più vivo
V. Allegro
VI. Andantino
VII. Allegro
VIII. Ancora poco meno : «Contento forse vivere» (soprano)
IX. Allegro assai
X. Allegro – Alla breve : «Con queste paroline» (basse)
XI. Andante : «Sento dire no’ncè pace» (soprano, ténor et basse)
XII. Allegro : «Chi disse ca la femmena» (ténor)
XIII. Presto : «Ncè sta quaccuna pò» (soprano et ténor) / «Una te fa la nzemprece» (ténor)
XIV. Allegro – Alla breve
XV. Tarantella
XVI. Andantino: «Se tu m’ami» (soprano)
XVII. Allegro
XVIII. Gavotta con due variazioni
XIX. Vivo
XX. Tempo di minuetto: «Pupillette, fiammette d’amore» (soprano, ténor et basse)
XXI. Finale : Allegro assai
[40 min]
Distribution
Orchestre national de Lyon
Nikolaj Szeps-Znaider direction
Siobhan Stagg soprano
Christopher Sokolowski ténor
Edwin Crossley-Mercer baryton
Ici Auvergne-Rhône-Alpes partenaire de l’événement.
Télérama partenaire de l’événement.
Introduction
Quelle mer, quel océan inspira Maurice Bouchor dans les poèmes à l’origine du Poème de l’amour et de la mer (1892) ? Peu importe finalement, tant il apparaît que cette houle n’est autre que celle de nos cœurs. Chausson tisse une somptueuse fresque où l’orchestre enserre la voix dans le flux et le reflux des vagues. S’il fallait trouver un équivalent à cet ensemble, ce serait les Quatre Derniers Lieder de Richard Strauss, composés un demi-siècle plus tard dans la même opulence orchestrale postromantique : la nature y est pareillement la métaphore de la vie humaine. Le ton est beaucoup plus léger dans Pulcinella, ballet de Stravinsky librement inspiré de la commedia dell’arte (les déboires amoureux de Polichinelle) et construit sur des fragments musicaux de contemporains de Carlo Goldoni, notamment Giovanni Battista (ou Giambattista) Pergolesi. L’ONL et Nikolaj Szeps-Znaider en jouent la version d’origine, le ballet de 1919, qui inclut trois chanteurs.
Texte : Auditorium-Orchestre national de Lyon
Chausson, Poème de l’amour et de la mer
Composition : de 1882 au 13 juin 1892.
Création (version pour voix et piano) : Bruxelles, 21 février 1896, par Désiré Demest (ténor) et l’auteur au piano ; (version pour voix et orchestre) : Paris, 8 avril 1896, par Éléonore Blanc (soprano) et l’Orchestre de la Société nationale de musique sous la direction de Gabriel Marie.
Dédicace : à Henri Duparc.
Comme de nombreuses autres mélodies de Chausson, le Poème de l’amour et de la mer repose sur des poèmes d’un ami du compositeur, Maurice Bouchor, auteur aujourd’hui oublié mais qui eut son heure de gloire (il possède même une rue dans le XIVe arrondissement de Paris). L’œuvre regroupe six poèmes empruntés aux deux premiers volumes du recueil presque homonyme Poèmes de l’amour et de la mer (1875) – volumes dont les deux volets de la partition prendront le nom (La Fleur des eaux et La Mort de l’amour).
La composition se fait par étapes : en 1882, à peine sorti de la classe de Jules Massenet au Conservatoire de Paris, Chausson met en musique les trois poèmes issus de La Fleur des eaux. Quatre ans plus tard, il met en musique Le Temps des lilas, qu’il publie isolément dans sa forme pour chant et piano ; par la suite, il le fait précéder de deux autres poèmes de La Mort de l’amour. Le 21 février 1896, la version pour chant et piano du Poème est présentée à Bruxelles par Désiré Demest et l’auteur au clavier. Éléonore Blanc et l’Orchestre de la Société nationale de musique créent la version orchestrale le 8 avril suivant à Paris.
Par cette œuvre, Chausson montre la singularité de son inspiration. Le principal modèle qui s’offrait à lui en matière de mélodie française avec orchestre était le recueil des Nuits d’été d’Hector Berlioz, publié en 1841 et orchestré quinze ans plus tard. Mais si les liens entre les six mélodies de Berlioz étaient assez lâches, rien n’empêchant d’en exécuter certaines isolément du tout, le diptyque de Chausson forme un ensemble indissoluble puisque les deux volets sont reliés par un interlude orchestral et que plusieurs autres éléments thématiques assurent la cohésion du tout.
Deux grands thèmes irriguent toute la partition. Le premier, présenté par les violons au début de l’œuvre, réapparaîtra sous de nombreux visages – notamment à l’entrée de la voix. Au-delà de sa beauté intrinsèque, il tire sa magie de son ambiguïté tonale et modale (il commence en sol majeur, mais l’écho aux vents se fait en mi mineur). Si le premier thème est présenté d’entrée de jeu puis se métamorphose, le second thème effectue le cheminement inverse : il est évoqué par bribes, puis de manière plus explicite dans l’interlude (solo de basson), mais ne trouvera sa pleine expression que dans Le Temps des lilas.
Le mouvement des vagues se traduit dans le détail de l’écriture : les dessins ondulants des motifs, les mouvements contraires entre les voix, les éclaboussures de lumière. Mais la grande forme est elle aussi un incessant mouvement de flux et de reflux entre passages exaltés et désolés, entre voix et orchestre (chacun des deux volets chantés se subdivise lui-même en trois poèmes, et ces poèmes en trois sections, toutes ces subdivisions encadrées de postludes, interludes et postludes orchestraux).
On a souvent parlé d’influence wagnérienne dans ce cycle – de 1879 à 1882, Chausson avait fait le voyage à Munich, puis à Bayreuth, s’enthousiasmant successivement pour Le Vaisseau fantôme, le Ring, Tristan et Isolde et Parsifal. Mais, au-delà de l’idée même d’inclure la voix dans un discours orchestral aussi élaboré, s’il est un Wagner auquel cette partition fait penser c’est plutôt celui, lumineux et tendre, de Siegfried-Idyll, au moins dans les premières pages. Après le choc de Parsifal en 1882, le style de Chausson s’écarta en effet progressivement de celui de Wagner pour trouver sa voie propre – sous l’influence de ses deux maîtres, Jules Massenet (notamment dans l’écriture vocale et l’orchestration) et César Franck (dans l’harmonie chromatique et le maniement de la forme).
S’il fallait trouver un équivalent de ce cycle dans le monde germanique, peut-être faudrait-il le chercher auprès de l’autre Richard, Strauss, et de ses Quatre Derniers Lieder, postérieurs d’un demi-siècle (1949) mais issus d’un style postromantique assez proche. La nature y est pareillement la métaphore de la vie : le cycle impitoyable des amours qui se font et se défont chez Chausson, celui de la vie qui s’effrite et du temps qui passe chez Strauss. Les deux recueils exaltent l’ivresse d’un printemps radieux, avec ses chants d’oiseaux réjouis, ses parfums floraux et ses couleurs, pour plonger dans un automne envahi par la mélancolie. L’orchestre de Strauss sera plus massif, plus luxuriant encore. Mais la palette de Chausson laisse la même impression d’opulence, de vie intense, d’hédonisme sonore, jusque dans la désolation des derniers vers.
– Claire Delamarche
Stravinsky, Pulcinella
Commande : Serge Diaghilev.
Composition : Morges (Suisse), du septembre 1919 au 21 avril 1920.
Création : Opéra de Paris, 15 mai 1920, par les Ballets russes, dans une chorégraphie de Léonide Massine, des décors et costumes de Pablo Picasso, sous la direction musicale d’Ernest Ansermet.
Le ballet Pulcinella est l’un des joyaux de la riche collaboration entre Stravinsky et Serge Diaghilev, le fondateur et directeur des Ballets russes, inaugurée en 1910 avec L’Oiseau de feu. La genèse de l’œuvre semble fortuite et contingente ; pourtant, celle-ci allait engager Stravinsky dans une réorientation esthétique majeure de sa carrière, inaugurant sa période «néo-classique».
Diaghilev venait de faire représenter à Rome en 1917 un ballet intitulé Les Femmes de bonne humeur dont la musique consistait en une orchestration de sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti, réalisée par le compositeur Vincenzo Tommasini. Le succès de ce spectacle auprès du public conduisit Diaghilev à demander à Stravinsky d’en faire autant avec une liasse de fragments manuscrits de Giovanni Battista Pergolesi, alias Pergolèse (1710-1736) retrouvés dans les archives de conservatoires italiens. Diaghilev s’attendait à une simple orchestration dans le style de l’époque, mais le projet enthousiasma Stravinsky, qui en fit une véritable recréation. Les musicologues s’étant depuis penchés sur la question, il s’avéra que les sources utilisées par Stravinsky n’étaient pas toutes de Pergolèse (seulement dix des vingt et un fragments utilisés sont de lui, tirés de ses commedie in musica ou de sa musique instrumentale), mais aussi de divers obscurs compositeurs italiens de la même époque (Domenico Gallo, Carlo Ignazio Monza,…) ou puisés dans un recueil d’Arie antiche, bien connu des apprentis chanteurs classiques, publié par Alessandro Parisotti. Peu importe d’ailleurs : on y trouve une unité stylistique qui intéressait Stravinsky dans la mesure où il pouvait facilement en décortiquer le fonctionnement pour mieux se l’approprier.
C’est ainsi que Stravinsky, après avoir été le porte-flambeau d’un modernisme musical radical, avec Le Sacre du Printemps (1913), rituel païen archaïque et sauvage, abandonne les sujets russes et se tourne vers la civilisation occidentale la plus policée, pour mieux en détourner les conventions et l’académisme, en une distanciation ironique. Le jeu des formes abstraites de la musique «par son essence impuissante à exprimer quoi que ce soit» lui semble un cadre approprié pour exercer sa prodigieuse faculté d’invention et son artisanat technique méticuleux, en se situant résolument en dehors de toute expressivité romantique.
«Pulcinella fut une découverte du passé, l’épiphanie grâce à laquelle l’ensemble de mon œuvre à venir devint possible. C’était un regard en arrière, certes, la première histoire d’amour dans cette direction-là ; mais ce fut aussi un regard dans le miroir.»
Stravinsky, Expositions and Developments
L’argument du ballet, tout aussi stylisé, est sans grande importance : tiré d’un canevas traditionnel de la commedia dell’arte, il met en scène les aventures galantes de Pulcinella (Polichinelle), où masques et travestissements permettent toutes sortes de rebondissements. La chorégraphie de Léonide Massine, les décors et costumes de Pablo Picasso renforçaient la stylisation des formes et des mouvements.
Ce concert présente la musique intégrale du ballet, et non la suite de seulement onze numéros que Stravinsky en a tirée en 1922, bien plus souvent jouée en concert. C’est donc une occasion rare d’entendre les parties vocales, confiées à trois solistes (à l’origine, ils étaient intégrés à l’orchestre et complètement indépendants des personnages dansés qui évoluaient sur scène). L’orchestre est réduit à un ensemble de trente-trois instrumentistes aux sonorités aiguisées et transparentes, résolument décapé de toute emphase expressive. Les cordes se répartissent, comme dans les concertos baroques, en concertino (groupe de cinq solistes) et ripieno. Le choix des timbres, essentiel, transforme complètement la musique de Pergolèse et consorts en un kaléidoscope de sonorités tour à pastorales ou grinçantes, brillantes ou grotesques, aux articulations accentuées et effets sonores recherchés, permettant de souligner des détails secondaires d’écriture qui normalement seraient passés inaperçus. Stravinsky conserve des originaux la ligne mélodique et l’allure rythmique générale, en composant une suite de mouvements brefs soigneusement contrastés. Mais il s’amuse à enrichir les harmonies de «notes à côté» et à gauchir subtilement les enchainements d’accords ainsi que les marches harmoniques trop attendues. Le style plaisant de Pergolèse devient la matière première de sa pensée, un masque qui lui permet d’être lui-même, le maître du jeu.
– Isabelle Rouard
Nos partenaires