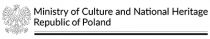Programme détaillé
Ouverture pour orchestre
[6 min]
Symphonie n° 2, en la mineur
I. Allegro giusto
II. Lento
III. Scherzo
IV. Finale : Allegro molto
[27 min]
-- Entracte ---
Harold en Italie, symphonie en quatre parties avec alto principal, op. 16, H 68
I. Harold aux montagnes. Scènes de mélancolie, de bonheur et de joie : Adagio – Allegro
II. Marche de pèlerins chantant la prière du soir : Allegretto
III. Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse : Allegro assai – Allegretto – Allegro assai
IV. Orgie de brigands. Souvenirs des scènes précédentes : Allegro frenetico
[43 min]
Avec le soutien du ministère de la Culture et du Patrimoine national de Pologne.
Dans le cadre d’Unanimes ! Avec les compositrices. Attentif depuis plusieurs années à la place des femmes dans sa programmation, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon participe à cette initiative de l’Association française des orchestres (AFO) dédiée à la promotion des compositrices et de leur répertoire.
Distribution
Orchestre national de Lyon
Nikolaj Szeps-Znaider direction
Antoine Tamestit alto
Introduction
Inspiré par un long poème narratif de Lord Byron (Le Pèlerinage de Childe Harold, 1811), Harold en Italie (1934) fait partie de ces partitions où Berlioz se met en scène lui-même, ici en jeune homme romantique qui pérégrine dans les paysages italiens. Il écrivit à l’intention de Niccolò Paganini cette «symphonie avec alto principal», mais l’illustre virtuose du violon refusa de la jouer parce qu’elle n’était pas assez brillante à son goût. Mars 1846 : Berlioz arrive à Wrocław, capitale de la Silésie alors intégrée à la Prusse sous le nom de Breslau. Assistant notamment à la reprise d’un mouvement d’Harold en Italie, il constate que la recette du concert est d’un montant inespéré. Assurément, le public polonais aime la musique française. Au siècle suivant, la France devient la terre d’adoption de Tansman, dont elle fait un de ses compositeurs fétiches avant de l’oublier. La Deuxième Symphonie (1926) est dédiée au chef d’orchestre Serge Koussevitzky, qui l’emporte rapidement aux États-Unis. Sa radiodiffusion y provoque un tel enthousiasme que le compositeur polonais est aussitôt invité pour des tournées outre-Atlantique. C’est là qu’il trouvera asile lorsque, naturalisé français, il devra fuir l’antisémitisme durant la guerre. De l’occupation allemande, l’Ouverture de Grażyna Bacewicz (1943) rappelle les heures noires dans l’attente de la victoire.
Texte : Auditorium-Orchestre national de Lyon
Bacewicz, Ouverture
Composition : 1943.
Création : Cracovie, 1er septembre 1945, dans le cadre du Festival de musique polonaise contemporaine, par l’Orchestre philharmonique de Cracovie placé sous la direction de Mieczysław Mierzejewski.
Trois périodes : c’est ainsi que Grażyna Bacewicz découpe sa propre histoire de compositrice, distinguant les expérimentations de jeunesse, un épisode atonal et qualifié à tort de néo-classique, puis un style de maturité, témoin de son évolution plutôt que d’une révolution, de sa longue réflexion sur le langage musical, adoptant librement la modernité du sérialisme notamment. Probablement l’histoire soviétique de la Pologne a-t-elle empêché Grażyna Bacewicz de pouvoir profiter d’une carrière qui aurait dû être la sienne ; professeur au Conservatoire d’État de musique de Łódź, elle a été soumise, comme tout artiste, au contrôle des autorités idéologiques, mais sa musique assurément dit combien cette musicienne était maîtresse de son art et à l’écoute de son époque.
Née à Łódź d’une mère polonaise et d’un père lituanien, Grażyna Bacewicz a suivi un parcours très académique. De son père également compositeur, elle a reçu ses premières leçons de piano et de violon : premier concert à l’âge de 7 ans, premières pièces, Préludes pour piano, à l’âge de 13 ans. Elle entre ensuite au conservatoire de Varsovie et entreprend l’étude de la philosophie à l’université. Dans les années trente, une bourse lui permet de séjourner à Paris afin de travailler la composition et le violon, respectivement auprès de Nadia Boulanger et d’André Touret. Puis ses qualités d’instrumentiste lui valent le poste de premier violon de l’Orchestre de la Radio polonaise, sous la direction du célèbre chef Grzegorz Fitelberg, et alors qu’elle se produit encore comme pianiste. Puis la guerre éclate et, dans une Pologne occupée par les Allemands, elle organise secrètement des concerts. Jamais elle ne cesse d’écrire, et dans ces heures difficiles conçoit son Ouverture, qui attendra l’issue du conflit pour être révélée au public.
«La majorité des compositeurs polonais se sont affranchis de l’influence de Szymanowski, explique Grażyna Bacewicz. Dans mes compositions, je fais surtout attention à la forme. Si vous construisez quelque chose, vous n’empilerez pas de pierres au hasard les unes sur les autres. C’est la même chose qu’une œuvre musicale. Les principes de construction ne doivent pas être démodés. La musique peut être simple ou compliquée. Cela dépend du compositeur, mais il faut que ce soit bien construit.» La forme de l’Ouverture est claire, à l’image de l’ouverture à l’italienne (vif, lent, vif), et solidement posée sur un motif rythmique unique, présenté par les timbales et circulant ensuite parmi tous les instruments. Il a parfois été suggéré que ce rythme, proche du motif de la Cinquième Symphonie de Beethoven, ait pu vouloir exprimer des vœux de victoire, suivant les principes du code Morse adopté sur les radios alliées. Quoi qu’il en soit, c’est un bel effet que celui produit par les cordes, tournoyant dans un mouvement perpétuel comme dans une tarentelle, tandis qu’éclate le thème des cuivres. Ce ne sont pas des sonneries militaires, mais une affirmation volontaire, le triomphe de la vie aux heures noires de la guerre.
– François-Gildas Tual
Tansman, Symphonie n° 2
Composition : 1926.
Dédicace : à Serge Koussevitzky.
Création : Boston, Symphony Hall, 18 février 1927, par l’Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Serge Koussevitzky.
Alexandre Tansman a été rapidement conquis par l’effervescence musicale parisienne lorsque, venant de soutenir sa thèse et d’achever sa formation à Varsovie, il s’est installé en France pour y faire carrière. Dans sa Pologne natale, il avait remporté les trois premiers prix d’un concours de composition après avoir présenté trois œuvres sous trois noms différents ; à Paris, la modernité était reine et, loin de s’affronter dans une concurrence stérile, les compositeurs s’écoutaient mutuellement, se soutenaient et partageaient volontiers leurs idées. Certes, les débuts n’ont pas été si faciles. Tansman a dû accepter de petits métiers, emballeur à La Villette avant d’être accueilli par une banque intéressée par sa maîtrise des langues. Bientôt, il a pu toutefois vivre de la musique, de leçons de piano puis de concerts. Ravel l’ayant recommandé à ses éditeurs, au chef d'orchestre Vladimir Golschmann ainsi qu’au fondateur de la Revue musicale, Henri Prunières, il a aussi profité des Lundis de Roland-Manuel pour rencontrer les compositeurs en vogue : Darius Milhaud, Arthur Honegger, Albert Roussel, Florent Schmitt ou Jacques Ibert. Ses œuvres sont programmées, plus ou moins bien reçues par la critique et le public, particulièrement appréciées par nombre de ses pairs.
C’est sans doute au cours d’un concert de Vladimir Golschmann que la musique de Tansman a retenu à l’attention de Serge Koussevitzky. Tansman dédie donc deux partitions au chef d’orchestre, un Scherzo sinfonico et une Légende donnés tous deux en mai 1923 et mai 1924. Cette année-là, Koussevitzky est nommé à la tête de l’Orchestre symphonique de Boston. C’est ainsi qu’il importe régulièrement aux États-Unis les ouvrages dont il vient d’assurer la création au sein des concerts parisiens qui portent son nom. La création de la Symphonie en la mineur est alors à l’origine d’une curieuse confusion. Dans son petit livre consacré à Tansman et publié par l’éditeur Eschig dès 1931, le musicologue américain Irving Schwerke raconte que l’œuvre a été donnée en première audition à Boston, le 17 novembre 1927, et que c’est encore Koussevitzky qui l’a présentée au public parisien, le 28 mai 1927. La formulation est contradictoire, suggérant une inversion ou une erreur de date, voire une méprise avec une diffusion radiophonique. Toujours est-il que le concert au Théâtre des Champs-Élysées est sûr, confirmé par les comptes rendus de la presse. Une «œuvre maîtresse» selon L’Avenir, manquant un peu des trouvailles et âpretés harmoniques des précédents ouvrages selon Comoedia, fort habile mais sans grande personnalité selon Le Ménestrel, qui relève quelques liens avec Stravinsky, Rimski-Korsakov et Ravel. Peut-être la symphonie a-t-elle un peu souffert de la méfiance des critiques parisiens vis-à-vis de la technique de direction de Koussevitzky. Parce que, selon une indication d’un journal, le chef essaie désormais les ouvrages à Boston avant de les reprendre à Paris, l’erreur de date semble la plus probable. En 2011, le musicologue Gérald Hugon tente de la corriger en situant la création américaine au mois de février de la même année (L’Œuvre d’Alexandre Tansman, catalogue pratique). Les archives de Boston nous révèlent finalement que la première a eu lieu les 18 et 19 mars 1927. Comme toujours à Boston, de riches notes de programme sont rédigées par Philip Hale, qui cite le compositeur – on notera qu’Irving Schwerke s’est ensuite approprié les mots du compositeur ainsi que toute sa description de la symphonie :
«La totalité de ma symphonie est conçue comme de la musique absolue, symphonique, avec un matériau exclusivement sonore, dans lequel le dynamisme moderne et l’intense pulsation contemporaine, non seulement n’excluent pas, mais encore exigent une effusion lyrique présente dans toutes mes œuvres de ces dernières années… Du point de vue de l’orchestration, je n’ai pas cherché le pittoresque, ni un jeu sportif avec les timbres comme dans certaines autres de mes compositions. Le matériau symphonique réclame avant tout la sobriété des moyens sonores, et la progression mélodique appelle à une certaine continuité instrumentale.»
Tansman n’ayant jamais reçu de leçons d’orchestration, il en a appris les rudiments au sein de l'Orchestre symphonique de Łódź pendant la Première Guerre mondiale, tenant au piano la partie de harpe absente. Respectant les formes classiques du genre, héritant aussi bien de la vieille combinaison thématique de la forme sonate que de l’alternance du rondo, sa symphonie n’en est pas moins colorée, cultive le contraste dès ses premières mesures fort abruptes. Recourant à tout l’effectif orchestral, elle déploie de longues mélodies sans s’appliquer à en isoler les motifs générateurs. Un développement mélodique plutôt que thématique, note Irving Schwerke. Le deuxième thème, plus doux, étant rapidement rattrapé par les interventions de percussions, le premier mouvement entraîne l’auditeur dans des ramifications déconcertantes mais à l’énergie toujours débordante. Pour Paul Le Flem, critique de Comoedia, le meilleur morceau est toutefois le mouvement lent : «[Il] chante avec franchise un thème très pénétrant qui touche par sa constante distinction et des accents d’une sensibilité non fardée.» Une parenthèse apaisante avant que le rythme enivrant n’emporte de nouveau le public dans le scherzo. Avec son finale aux nombreuses fanfares et tournures de chansons populaires, Tansman a-t-il voulu charmer définitivement les oreilles américaines ? Si quelques solos de flûtes ravissants et français dans l’âme surgissent ci-et-là, la symphonie prépare de la meilleure des manières les prochaines tournées du compositeur outre-Atlantique ; durant la guerre, forcé à l’exil, Tansman trouvera d’ailleurs en Amérique un indispensable asile.
– François-Gildas Tual
Berlioz, Harold en Italie
Composition : entre décembre 1833 et juillet 1834.
Création : Paris, salle du Conservatoire, 23 novembre 1834, soliste Chrétien Uhran, direction Narcisse Girard.
Dédicace : à Humbert Ferrand.
Comme la célèbre Symphonie fantastique, suivie du «mélologue» Lélio, ou l’opéra Benvenuto Cellini, un certain nombre d’œuvres de Berlioz ont pour sujet la vie d’un artiste, et révèlent donc une part d’identification autobiographique. Dans Harold en Italie, cette identification est passée au filtre de la littérature. Le jeune Harold est le héros d’un long poème narratif de Lord Byron (Le Pèlerinage de Childe Harold, 1811) que Berlioz avait lu avec enthousiasme pendant son séjour en Italie. Et l’on peut dire aussi que c’est Berlioz lui-même, jeune homme romantique qui pérégrine dans les paysages italiens.
L’artiste est un spectateur, un rêveur, il ne prend pas part aux scènes qu’il observe. Dans cette deuxième symphonie de Berlioz, c’est l’alto solo qui le représente, et son thème qui parcourt les quatre mouvements, comme l’«idée fixe» de la Symphonie fantastique, se superpose aux différentes ambiances musicales traversées, sans jamais en être le motif principal. D’ailleurs, puisque ce n’est pas un concerto, l’alto dialogue très peu avec l’orchestre, sauf dans le premier mouvement.
Le choix de l’alto soliste, au timbre chaleureux et plus voilé que celui d’un violon, donne à ce personnage une personnalité introvertie et mélancolique. Ce choix résulte aussi d’une demande du grand violoniste Niccolò Paganini, dont Berlioz venait de faire la connaissance. Celui-ci l’avait encouragé à écrire une œuvre destinée à mettre en valeur «un admirable alto de Stradivarius» qu’il possédait (en effet le répertoire concertant pour l’alto était alors quasiment inexistant, outre quelques concertos baroques totalement oubliés alors). Paganini ne joua jamais l’œuvre de Berlioz en public, la partie soliste n’étant pas assez brillante à son goût, mais il conserva son admiration pour le compositeur et l’assura d’un soutien indéfectible et généreux.
«Je voulus faire de l’alto, en le plaçant au milieu des poétiques souvenirs que m’avaient laissées mes pérégrinations dans les Abruzzes, une sorte de rêveur mélancolique dans le genre du Childe Harold de Byron.»
(H. Berlioz, Mémoires)
Le premier mouvement commence par un sombre fugato sur un motif tourmenté qui part des profondeurs : la vision romantique de la montagne était alors celle d’un lieu terrible et inhospitalier. Mais les nuages se dissipent vite, à l’apparition du héros (thème joué à l’alto en mode majeur, accompagné par les sonorités éthérées et romantiques de la harpe). L’Allegro qui suit est un moment de pure énergie et de liberté dans un paysage grandiose.
La «Marche des pèlerins» est une vision panoramique, construite en crescendo-decrescendo : on ressent l’approche et l’éloignement du cortège, alors qu’un point fixe – le tintement de deux cloches – résonne dans l’immense espace sonore. Ce mouvement est de nature quasi expérimentale : dosage méticuleux des nuances de l’orchestre, pérégrinations modulantes du cortège où s’intègrent néanmoins toujours le tintement des deux notes fixes (do : cor et harpe, si : flûte, hautbois, harpe), superposition du thème d’Harold puis séquence de bariolages (arpèges) accompagnant un cantique aux sonorités archaïques («canto religioso»).
En guise de scherzo, la «Sérénade» est un écho des escapades de Berlioz dans les Abruzzes, où la musique populaire l’avait fortement frappé : elle oppose une joyeuse saltarelle accompagnée en bourdon (hautbois et piccolo évoquant la musique des bandes de pifferari), et une naïve sérénade villageoise chantée au cor anglais.
Au début du finale, le rappel de la musique des précédents mouvements est un procédé venu en droite ligne du final de la Neuvième Symphonie de Beethoven, que Berlioz venait de découvrir en concert. Il prélude à une orgie sonore, où les brigands sont une métaphore de l’audace, d’une la liberté débridée et d’une féroce joie de vivre. Le soliste n’y apparait plus comme un individu mais est emporté par ce tourbillon sonore à la fois festif et violent.
– Isabelle Rouard
Polska
Amie séculaire de la France, la Pologne se distingue par une richesse musicale extraordinaire et une scène artistique foisonnante. La saison 2025/2026 de l’Auditorium met en lumière ces trésors, offrant une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les œuvres de compositeurs tels que Szymanowski, Lutosławski, Bacewicz, Szpilman, Zarębski, Kurpiński, Weinberg, Tansman et bien sûr Chopin. Des artistes polonais de renom – Marta Gardolińska, Karol Mossakowski, l’ensemble Arte dei Suonatori, le Quatuor Equilibrium, entre autres – nous honorent par ailleurs de leur présence à Lyon, apportant leur talent pour enrichir ce fil rouge artistique aussi captivant qu'original.