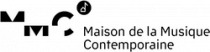◁ Retour au concert des jeu. 30 sept. et sam. 2 oct. 2021
◁ Retour au concert pour les étudiants du ven. 1er oct. 2021
Programme détaillé
Sinfonia n° 4, «Strands»
[13 min]
Concerto pour violon en ré majeur, op. 35
I. Moderato nobile
II. Romance : Andante
III. Finale : Allegro assai, vivace
[24 min]
--Entracte--
Symphonie n° 9, en mi mineur, op. 95, «Du Nouveau Monde»
I. Adagio – Allegro molto
II. Largo
III. Scherzo : Molto vivace
IV. Allegro con fuoco
[40 min]
Orchestre national de Lyon
Nikolaj Szeps-Znaider direction
Stefan Jackiw violon
Le concert du 30 septembre est enregistré par Radio Classique. Il sera diffusé sur Radio Classique (96.5 FM) le dimanche 31 octobre 2021, puis disponible en streaming pendant 1 an.
Avec le soutien de la Maison de la musique contemporaine.
La Note du chef
Mes identités mêlées me rendent naturellement très sensible au rapport ambivalent que les artistes peuvent entretenir avec l’idéal abstrait d’un Nouveau Monde d’une part, et la réalité américaine de l’autre. Ce qui rend, à mon sens, ce programme passionnant tient dans les trois éclairages qu’il apporte, aussi contrastés que complémentaires. On adopte le point de vue du voyageur avec Dvořák, dans une œuvre si souvent entendue que je pensais, à tort, qu’elle m’intéresserait moins, avant de commencer à la diriger et d’en tomber amoureux. Son paradoxe tient évidemment à ce que ses thèmes mondialement connus passent pour une description des grands horizons américains, alors qu’ils chantent la nostalgie du pays natal ! Mais Dvořák retrouvera sa Bohême, tandis que Korngold est un exilé qui a fui la mort. Quand il tentera un retour à Vienne après-guerre, il ne pourra que constater que le monde qu’il aimait n’existe plus. George Walker, fils d’émigré jamaïcain et premier artiste afro-américain à remporter le prix Pulitzer de composition, illustre enfin le combat de celui qui trouve dans un pays neuf des chances exceptionnelles, mais doit aussi lutter chaque jour pour faire entendre sa voix.
– Nikolaj Szeps-Znaider
Directeur musical
Walker, Sinfonia n° 4
Commande : Orchestres symphoniques du New Jersey, de Pittsburgh, de Cincinnati et National Symphony Orchestra, avec le soutien de Meet The Composer.
Composition : 2012.
Création : Newark (New Jersey), New Jersey Performing Arts Center, 30 mars 2012, par l’Orchestre symphonique du New Jersey sous la direction de Jacques Lacombe.
Natif de Washington, fils d’un médecin issu de de la communauté jamaïcaine, George Walker reçoit ses premières leçons de musique de sa mère avant de poursuivre sa formation au Conservatoire d’Oberlin et au Curtis Institute of Music (Philadelphie). Élève de Rudolf Serkin pour le piano, de William Primrose et de Gregor Piatigorsky pour la musique de chambre et de Rosario Scalero pour la composition, il est le premier noir diplômé en musique du Curtis Institute, le premier aussi à se produire en récital à l’hôtel de ville de Manhattan, puis à être sélectionné par l’Orchestre de Philadelphie pour jouer le Troisième Concerto de Rachmaninov sous la direction d’Eugene Ormandy. Le premier encore à obtenir un doctorat de l’Eastman School of Music (Rochester). Lauréat du prix de composition John-Hay-Whitney, il vient en France dans les années cinquante afin d’y suivre les cours de Nadia Boulanger, puis mène une carrière universitaire aux États-Unis, récipiendaire en 1996 du prix Pulitzer pour Lilacs, sur un poème de Walt Whitman en hommage à l’abolitionniste Abraham Lincoln.
Le parcours de George Walker est d’autant plus exceptionnel que le présage d’Antonín Dvořák, selon lequel l’avenir de la musique classique américaine s’appuierait «sur ce que l’on appelle les mélodies noires», ne s’est guère réalisé ; parmi les rares noms de musiciens afro-américains retenus par la postérité, on retient celui de William Grant Still, compositeur d’une Symphonie afro-américaine et du Chant d’une nouvelle race, ainsi que celui de Florence Price, double victime du racisme et du sexisme. Dans une entrevue avec Bruce Duffie en 1987, George Walker commente : «J’ai profité du fait d’être un compositeur noir en ce sens que s’il y avait des symposiums avec de la musique de compositeurs noirs, j’obtenais des commandes d’orchestres qui, autrement, n’auraient pas joué ces œuvres. L’autre aspect, bien sûr, c’est que, si je n’avais pas été noir, j’aurais eu une plus grande diffusion de ma musique et plus de concerts.»
En un mouvement unique, la symphonie Strands a été écrite dans le cadre d’un projet destiné à promouvoir la musique des compositeurs nés ou ayant vécu dans le New Jersey. Une excellente occasion de célébrer le quatre-vingt-dixième anniversaire de ce musicien auquel l’orchestre a déjà commandé, une quinzaine d’années plus tôt, Pageant and Proclamation pour l’inauguration de l’auditorium du New Jersey Performing Arts Center. Strands, explique George Walker, «fait référence à l’interaction de plusieurs éléments mélodiques et motiviques qui sont fusionnés dans une texture semblable à une mosaïque». On y décèle un dessin introductif de quatre notes, un thème principal énoncé par les violons, des citations de spirituals : There Is a Balm in Gilead et Roll, Jordan, Roll. Leur imbrication repose sur un art consommé de l’instrumentation, avec des effets efficaces de notes répétées, des changements soudains de registre, ainsi qu’une métamorphose progressive des lignes jusqu’à leur confusion.
Les références renvoient bien sûr à l’histoire des noirs, à l’esclavage, au désir de liberté et à l’exil. Roll, Jordan, Roll, par exemple, descend de l’hymne du XVIIIe siècle There Is a Land of Pure Delight d’Isaac Watts, qui associe l’installation des Hébreux et le pays de Canaan à l’espoir d’une plus vaste maison céleste. Mais de cette puissante image orchestrale ne ressort nul souhait d’identification stylistique aux musiques afro-américaines. La pièce s’inscrivant dans la lignée des modèles européens, ce n’est pas, comme l’imaginait Dvořák, le son de la musique noire qui s’impose, mais l’intégration parfaite du musicien noir dans une histoire culturelle. Et probablement est-ce un tel positionnement qui a valu à George Walker d’être distingué par l’American Music Center pour «sa contribution significative au domaine de la musique contemporaine américaine», d’être élu à l’académie américaine des Arts et des Lettres, d’être intronisé au panthéon de l’American Classical Music Hall of Fame, et d’être récompensé par deux bourses Guggenheim, deux bourses Rockefeller, de nombreux prix et plusieurs doctorats honoris causa.
– François-Gildas Tual
Korngold, Concerto pour violon
Composition : 1937-1939, révisé en 1945.
Création : Saint-Louis (Missouri), 15 février 1947, par Jascha Heifetz et l’Orchestre symphonique de Saint-Louis, sous la direction de Vladimir Golschmann.
Dédicace : à Alma Mahler-Werfel.
Compositeur juif autrichien, enfant prodige, Erich Wolfgang Korngold rencontre très tôt le succès en Europe avec ses opéras. S’étant rendu à partir de 1934 à Hollywood pour travailler sur des musiques de film, il s’y installe de façon permanente en 1938 pour fuir le nazisme et fait vœu de ne rien écrire d’autre tant qu’Hitler sera au pouvoir. Il avait déjà obtenu deux Oscars, en 1937 (Anthony Adverse, de Mervyn LeRoy) et 1938 (Les Aventures de Robin des Bois, de Michael Curtiz). La fin de la Seconde Guerre mondiale le convainc de revenir à la musique de concert et d’achever son Concerto pour violon, commencé quelques années plus tôt à la demande du violoniste Bronisław Huberman. C’est finalement Jascha Heifetz qui en assurera la création en 1947, et qui le fera entrer au répertoire des grands concertos pour violon du XXe siècle.
Ayant développé dans ses musiques de film un sens mélodique très apprécié à Hollywood, Korngold utilise le violon dans ce qu’il a de plus expressif, tout en explorant les possibilités virtuoses de l’instrument. Il puise son matériau thématique dans ses musiques de film précédentes. Ainsi, le premier thème du premier mouvement, «Moderato nobile», est-il tiré de La Tornade de William Dieterle (1937), et le second thème de Juarez, du même réalisateur (1939). La cadence, traditionnelle démonstration de virtuosité laissée au soliste, précède la luxuriante réexposition du premier thème, à l’orchestre puis au violon. Le thème principal du deuxième mouvement, «Romance», provient d’Anthony Adverse. Le violon déploie une grande douceur dans tous les registres de sa tessiture, notamment dans l’extrême aigu. Une courte partie centrale, plus chromatique, rappelle les origines européennes de Korngold (notamment Zemlinsky, son professeur), avant le retour du thème principal. Le finale est un rondo à variations dont le thème est tiré du Prince et le Pauvre de William Keighley (1937). Dans ce mouvement, Korngold joue sur les paramètres de hauteur, de tonalité, de rythme, de mode de jeu, de tempo et d’orchestration, dans une écriture toujours plus virtuose qui finit dans une apothéose éblouissante.
– Hélène Codjo
Dvořák, Symphonie n° 9, «Du Nouveau Monde»
Composition : de Noël 1892 au 24 mai 1893.
Création : New York, Carnegie Hall, 15 décembre 1893, par l’Orchestre philharmonique de New York sous la direction d’Anton Seidl.
Création européenne : Londres, 21 juin 1894, sous la direction d’Alexander Mackenzie.
En juin 1891, Dvořák fut invité par la milliardaire américaine Jeannette Thurber à diriger le conservatoire qu’elle venait de fonder à New York. Il prit son poste en octobre de l’année suivante, pour trois ans. Première œuvre composée sur le sol américain, début 1893, la Symphonie «Du Nouveau Monde» inaugurait une série de chefs-d’œuvre teintés de nostalgie, au nombre desquels figureraient le Concerto pour violoncelle, le Quatuor à cordes en fa majeur «Américain» et le Quintette à cordes en mi bémol.
À en croire son assistant américano-tchèque, Jan Kovarík, Dvořák n’ajouta le sous-titre «Du Nouveau Monde» qu’à la dernière minute sur la partition envoyée au chef d’orchestre Anton Seidl ; il ne s’agissait là que de «l’une de ses innocentes plaisanteries, et cela ne voulait pas dire autre chose qu’“Impressions et salutations du Nouveau Monde”, comme il l’expliqua lui-même à plusieurs reprises». «Ceux qui ont le nez sensible y décèleront l’influence de l’Amérique», écrivit toutefois Dvořák en avril 1893, pour préciser plus tard que les allégations selon lesquelles il aurait employé des mélodies indiennes ou américaines n’étaient que «mensonges» et «absurdités» : «J’ai simplement écrit par moi-même des thèmes auxquels j’ai incorporé quelques particularités de la musique indienne ; et, pour que l’on ne me reproche pas ces thèmes, je les ai travaillés selon les critères les plus modernes du rythme, de l’harmonie, du contrepoint et de l’orchestration pour les charger d’émotion.» Et si l’on a pu reconnaître, dans le thème en sol majeur du premier mouvement, l’écho du negro-spiritual Sweet Home, Sweet Chariot, c’est coloré d’une manière si personnelle que l’âme tchèque y est tout aussi présente. La tendance pentatonique, les mélodies oscillant autour d’une note pivot, les syncopes et rythmes pointés, les septièmes degrés abaissés sont autant de traits que l’on a pu attribuer à l’influence américaine, mais dont la tradition tchèque regorge.
Une fois que les critiques locaux eurent fini de débattre du caractère «américain» de l’œuvre, Dvořák déclara, non sans malice : «Il semble que j’aie semé la confusion dans leurs esprits. Dans mon pays, on comprendra tout de suite ce que j’ai voulu exprimer !» Au nombre de ceux qui «comprirent» figure le grand chef tchèque Václav Talich, qui fit ce commentaire sur la symphonie : «Il paraît qu’elle comporte quelques mélodies noires-américaines. Je le crois et à la fois j’en doute. Peut-être Dvořák employa-t-il en effet des rythmes et des mélodies qu’il avait entendus autour de lui, mais n’entend-on pas, en écoutant l’œuvre, combien ces éléments étrangers ont été remodelés par le génie tchèque qui habite le compositeur ? Combien s’élève, de ces enveloppes magnifiques, une soif du sol natal que rien ne peut étancher, un mal du pays qui, à la fin de l’œuvre, culmine en un cri presque désespéré ?»
Suivant l’exemple de son mentor, Johannes Brahms, Dvořák tisse un réseau de correspondances dans la profusion de ses thèmes. La sonnerie de cor, thème principal de l’Allegro molto, intervient comme un coup de semonce dans les trois mouvements suivants. La parenté entre le motif de flûtes en sol mineur du premier mouvement, la célébrissime mélodie de cor anglais du second et le thème du trio du scherzo est évidente. Quant au trépidant finale, il reprend magistralement le matériau des trois volets précédents, en une splendide apothéose. Les deux mouvements centraux font écho à la commande, par Jeannette Thurber, d’un opéra sur le poème de Longfellow Le Chant de Hiawatha. Dvořák déclina l’offre mais promit d’illustrer le texte dans sa symphonie : le Largo évoque l’ensevelissement de Minnehehe, l’épouse du héros, et le scherzo la danse de Pau-Puk-Keewis lors des noces.
La présentation au public du Carnegie Hall de New York, le 15 décembre 1893 pour la répétition générale et le lendemain pour la création officielle, fut un triomphe. Chaque mouvement fut salué par un tonnerre d’applaudissements, auquel le compositeur devait répondre en saluant de sa loge «comme [s’il était] un roi !», ainsi qu’il le rapporta à son éditeur, Simrock. L’œuvre gagna l’Europe avec un succès toujours aussi considérable.
– Claire Delamarche