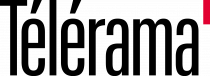◁ Retour aux concerts des jeu. 11 jan. et sam. 13 jan. 2024
Programme détaillé
Prélude de l’acte I de Lohengrin
[8 min]
Concerto pour piano n° 2, en la majeur
Adagio sostenuto assai – L’istesso tempo – Allegro agitato assai – Tempo del Andante – Allegro moderato – In tempo – Allegro deciso – Sempre allegro – Marziale, un poco meno allegro – Un poco animato – Allegro animato – Stretto
[21 min]
--- Entracte ---
Ein Heldenleben [Une vie de héros], poème symphonique op. 40
Der Held [Le Héros] – Des Helden Widersacher [Les Adversaires du Héros] – Des Helden Gefährtin [La Compagne du Héros] – Des Helden Walstatt [Le Champ de bataille du Héros] – Des Helden Friedenwerke [Les Œuvres de paix du Héros] – Des Helden Weltflucht und Vollendung [La Fuite du monde et l’Accomplissement du Héros].
[40 min]
Distribution
Orchestre national de Lyon
Nikolaj Szeps-Znaider direction
Kirill Gerstein piano
En partenariat avec Télérama.
Introduction
On associe au nom de Richard Wagner des sonorités puissantes et cuivrées, mais le prélude de son opéra Lohengrin (créé en 1850 à Weimar) montre un visage de douceur et de frémissements. Il faut bien cela avant d’affronter les deux monuments qui suivent, qui ne craignent ni les grandes envolées ni les décibels. Même si le Deuxième Concerto pour piano de Liszt (créé dans la même ville sept ans plus tard) dévoile de nombreux instants de tendresse, le caractère héroïque y domine le plus souvent. Et il faut bien un Kirill Gerstein, pur produit de ce que l’école russe de piano a de plus éblouissant, pour triompher de ces guirlandes légères et de ces cascades d’accords montant et dévalant le clavier.
Composé à la manière d’un poème symphonique, avec un thème unique soumis à toutes sortes de métamorphoses et de climats, le concerto fut surnommé par un critique américain «La Vie et les Aventures d’une mélodie». Par sa forme et par son caractère virtuose et extraverti, Une vie de héros (1899) poursuit dans la même veine. Le héros, c’est Strauss lui-même. Comme il le déclarera à Romain Rolland à propos de la Sinfonia domestica : «Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas une symphonie sur moi-même. Je me trouve aussi intéressant que Napoléon et Alexandre.» Le compositeur raconte ses batailles et ses victoires grâce à un orchestre énorme et virtuose, confiant au violon solo la voix de sa chère Pauline. Un défi de tous les instants pour les musiciens et le chef, un bonheur de tous les instants pour l’auditeur.
La note du Chef
J’aime le jeune Richard Strauss. Peut-être moins le garçon de 18 ans du Concerto pour violon, bien que je l’aie souvent joué. Mais celui qui, à partir de 25 ans, compose les grands poèmes symphoniques dont il développera la veine jusqu’à la Première Guerre mondiale, de Don Juan à Une symphonie alpestre. Je récuse totalement la vision de ceux qui voient dans le postromantisme allemand le signe d’une décadence annonciatrice des grandes catastrophes politiques et humaines du XXe siècle. Une vie de héros éblouit par l’apparente facilité de son écriture, la subtilité dont le compositeur fait preuve en nuançant la monumentalité de la forme et les élans grandioses d’un étreignant lyrisme et d’une ironie corrosive. Même si j’adore la période néoclassique qui suivra, Strauss ne retrouvera à mon sens un tel jaillissement d’invention, une telle sincérité, à bien des égards, que dans ses ultimes partitions, en se retournant sur sa vie après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale.
– Nikolaj Szeps-Znaider, directeur musical
Wagner, Prélude de l’acte I de Lohengrin
Composition : 1845 (livret), 1846-1848 (musique).
Création : Théâtre grand-ducal de Weimar, le 28 août 1850, sous la direction de Franz Liszt.
Avec Lohengrin, Wagner referme la page de ses «opéras romantiques» : ce sous-titre (qui caractérise aussi Le Vaisseau fantôme ou Tannhäuser) disparaîtra ensuite, éventuellement remplacé, dans les dernières œuvres, par «festival scénique» ou «festival scénique sacré». En parallèle, la découverte de Schopenhauer, notamment, le fera évoluer dans son esthétique. Pour autant, il n’est pas non plus de cassure brutale : trente ans après Lohengrin, Parsifal reviendra aux préoccupations chrétiennes de Wagner, préoccupations symbolisées par le Graal, emblème de la chrétienté médiévale, but par excellence des quêtes chevaleresques et incarnation du mystère du christianisme.
À propos du Vorspiel [prélude] qui ouvre Lohengrin, Liszt convoquera l’image d’un «éther vaporeux qui s’étend» – il savait de quoi il parlait : c’est lui qui donna notamment la première de l’œuvre, à Weimar en 1850, en l’absence de Wagner alors persona non grata en Allemagne à la suite de ses activités révolutionnaires l’année précédente.
L’évocation de Montsalvat, monde sacré du Graal d’où vient Lohengrin, inspire en effet au compositeur des accents recueillis, presque hypnotiques, que l’on retrouvera d’ailleurs dans le prélude de Parsifal, celui-ci (Parsifal) étant le père de celui-là (Lohengrin)… Ici, l’introduction dessine comme une sorte de résumé de la trajectoire de Lohengrin : débutant dans un aigu enveloppant de violons divisés à l’extrême que rejoignent ensuite les vents (piccolos, flûtes, hautbois), elle prend petit à petit plus de corps au fur et à mesure que l’instrumentarium s’étoffe, que la nuance s’élargit et que le registre orchestral s’étend vers les graves, avant d’entamer le chemin inverse. Image, donc, de l’apparition magique du chevalier mystérieux et de son départ après le dévoilement de son identité par Elsa de Brabant, le tout sur le leitmotiv* du Graal, bien sûr, avec sa quarte ascendante. De ce morceau enchanteur, Berlioz écrira : «C’est une merveille d’instrumentation dans les teintes douces comme dans le coloris éclatant […] ; c’est suave, harmonieux autant que grand, fort et retentissant : pour moi, c’est un chef-d’œuvre.»
– Angèle Leroy
* Leitmotiv : Wagner préférait parler de «thème fondamental», mais c’est le mot «Leitmotiv» [motif conducteur] qui s’est imposé pour évoquer le système de rappels musicaux construit par le compositeur pour évoquer des personnages, des objets ou des idées. Par le biais de ces motifs musicaux, dont la fonction dépasse celle de l’étiquetage (n’en déplaise à Debussy qui parlait de «bottin musical»), l’orchestre prend lui aussi un rôle de narrateur.
Liszt, Concerto pour piano n° 2
Composition : esquissé en 1839, révisé en 1849, 1853, 1857 et 1861.
Création : Weimar (Allemagne), 7 janvier 1857, par Hans von Brossart et l’Orchestre de la Cour de Weimar, sous la direction de l’auteur.
On a peine à imaginer, aujourd’hui, ce que fut la fulgurante carrière de pianiste de Liszt. De 1839 à 1847, durant ce qu’il appelait sa Glanz-Periode (ses années d’éclat), il donna plus de mille récitals, accumulant jusqu’à Gibraltar, Constantinople et l’Oural une renommée dont il continua à jouir bien après son retrait officiel de l’estrade, à l’âge de 35 ans. Liszt inventa le récital pour piano sous sa forme moderne. Le premier, il joua par cœur des programmes colossaux et fit placer le piano perpendiculairement à la salle, le couvercle renvoyant le son vers le public. Profitant des dernières innovations de la facture instrumentale, il développa une virtuosité surhumaine et fit tourner la tête à l’Europe entière, même à la capitale des Gaules, comme le rapporte avec emphase un journaliste du Ménestrel : «Pour se faire une idée de ce qui s’est passé à Lyon, il faudrait reporter ses souvenirs vers Alexandre le Grand et son entrée à Babylone…» Le premier, Liszt fut traité à l’égal d’un souverain ; une véritable révolution, si l’on songe que Bach, Haydn ou Mozart furent considérés comme des domestiques et que Beethoven était tout juste toléré par l’élite viennoise.
Dans ces années de gloire, Liszt composa énormément à son propre usage. Il s’attela notamment à deux concertos pour piano, dont la gestation devait toutefois s’étaler sur de nombreuses années. Le premier ne fut créé qu’en 1855, et devait encore subir un remaniement. Quant au second, ébauché en 1839, il fit l’objet de quatre révisions successives, en 1849, 1853, 1857 et 1861 respectivement. Il fut présenté au public le 7 janvier 1857, sous son avant-dernière forme. À l’époque, Liszt avait abandonné depuis longtemps sa carrière de virtuose. Il était alors maître de chapelle de la cour de Weimar, et l’essentiel de sa production concernait l’orchestre. Le Second Concerto se ressent de cette orientation nouvelle : au contraire du précédent, qui adopte une découpe assez classique en quatre mouvements et semble tout dévolu à la promotion du soliste, celui-ci est d’un seul tenant et se rapproche, structurellement et esthétiquement, des poèmes symphoniques contemporains. Derrière son allure imprévisible, on décèle aisément l’empreinte d’une structure très maîtrisée. Quels que soient les contrastes de climat, de couleur, de tempo, de nuance, il ne s’agit finalement que d’un seul thème, présenté dès le début par la clarinette puis le hautbois, dont l’on suit l’évolution comme celle d’un personnage – un critique américain, William Apthorp, décrivit l’œuvre comme «La Vie et les Aventures d’une mélodie». Même si Liszt ménage quelques instants de tendre intimité, notamment un dialogue très éloquent entre piano et violoncelle solo, le caractère héroïque domine ici et prend le dessus, à l’instar de poèmes symphoniques comme Tasso ou Les Préludes.
Liszt laissa un de ses élèves, Hans von Brossart, assurer la partie de piano lors de la création ; lui-même se tenait au pupitre de chef d’orchestre. La maîtrise de son écriture pianistique est cependant intacte : on reconnaît toute la palette des «effets» lisztiens, à la fois si spectaculaires et si séduisants : les guirlandes chromatiques, les volées d’octaves, les cascades d’accords, les arpèges évanescents, les traits scintillants dans l’aigu, les glissades dévalant le clavier. Malgré son éclat, la partie de piano est cependant plus intégrée à l’ensemble de l’orchestre que dans l’autre concerto, ce qui ajoute à l’impression symphonique laissée par la partition. Cette impression est toutefois balayée par une coda ébouriffante où le piano reprend le devant de la scène. Ce mélange de pur brio et d’émotion intense, de fantasque et de contrôle fait du Second Concerto l’une des pages les plus caractéristiques de Liszt, et l’une de ses plus réussies.
– Claire Delamarche
Strauss, Une vie de héros
Composition : du printemps 1897 à décembre 1898.
Création : Francfort-sur-le-Main (Allemagne), 3 mars 1899, sous la direction de l’auteur.
Né douze ans avant la Première Symphonie de Brahms, mort tandis que pointait l’école postsérielle de Darmstadt, Richard Strauss traversa les décennies sans perturbations majeures, fidèle au langage tonal hérité des derniers romantiques. «M. R. Strauss n’a ni mèche folle, ni gestes d’épileptiques», décrivit Debussy. «Il est grand et a l’allure franche et décidée de ces grands explorateurs qui passent à travers les tribus sauvages avec le sourire aux lèvres.» Adversaire de la musique «pure», il se raconta au travers de sept poèmes symphoniques où, de Don Juan (1888) à Une vie de héros (1897-1898), il se voyait en conquérant. Après ce point sur lui-même, il chanta inlassablement la féminité, dans la centaine de lieder et les treize opéras de sa maturité.
Les principales innovations de son langage concernent l’orchestration. Vents et cordes s’exposent dans des solos périlleux, et une virtuosité de chaque instant est exigée de tout l’orchestre, rassemblé en polyphonies extrêmement touffues où tout s’organise merveilleusement. La vitalité et l’incroyable flexibilité du colossal orchestre straussien éclatent tout particulièrement dans Une vie de héros, où le compositeur ne cacha pas s’être illustré lui-même.
«Je me trouve aussi intéressant que Napoléon et Alexandre.»
Pour son dernier poème symphonique, après s’être inspiré de Shakespeare (Macbeth), Nietzsche (Ainsi parlait Zarathoustra) et Cervantès (Don Quichotte), en plus de deux grandes figures légendaires – Don Juan et Till l’Espiègle –, Strauss ne pouvait imaginer sujet plus à propos que lui-même. Comme il le déclarerait à Romain Rolland en 1905, à propos de la Sinfonia domestica : «Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas une symphonie sur moi-même. Je me trouve aussi intéressant que Napoléon et Alexandre.»
Dès Une vie de héros, Napoléon apparaît en filigrane comme le modèle auquel il se compare : le choix de la tonalité de mi bémol est une référence à la Troisième Symphonie de Beethoven, l’illustre «Héroïque», dont on sait que son auteur voulait la dédier au Consul Bonaparte et en déchira la première page avec colère lorsque celui-ci s’autoproclama empereur. En toute modestie, c’est dans cette tonalité héroïque entre toute (les cuivres s’y sentent particulièrement à l’aise) que Strauss lance le thème principal, une phrase conquérante symbolisant le héros – lui-même. Il ne se lasse pas de se donner ainsi en spectacle, et cette présentation du héros se développe en un énorme paragraphe musical – plus de quatre minutes d’une musique emphatique qui reprend rarement son souffle.
Lorsque cette course s’arrête enfin, les vents introduisent le chapitre suivant de l’autobiographie : «Les Adversaires du Héros». Strauss y épingle les Philistins, critiques haineux, pédants de tous poils que les vents peignent à traits venimeux. Il parsème la partition d’indications de jeu fielleuses, exigeant des sons «très aiguisés et pointus» ou encore «grinçants»… à tel point qu’il redouta un accueil désastreux de la part de la critique. Mais celle-ci, bonne joueuse ou inconsciente de l’affront, lui dressa plus de lauriers pour cette œuvre que pour aucune autre, à l’exception de Guntram, son premier opéra.
Nous faisons ensuite la connaissance de la «Compagne du Héros». Sans être une «sitcom» familiale comme la Sinfonia domestica, Une vie de héros brosse un tableau haut en couleur des relations conjugales entre le compositeur et son épouse, la cantatrice Pauline de Ahna, que le musicologue David Hurwitz imaginait à travers cette partition comme «sexy, capricieuse, jalouse». Et, ajoutait-il non sans humour, «à la manière dont elle est dépeinte, il apparaît clairement que son mari a toutes les peines du monde à placer un mot dans la conversation». Strauss avoua qu’il était difficile de faire son portrait, tant «elle était à chaque instant différente de l’instant précédent». Mais Pauline fut toujours un soutien fidèle et, comme le confierait plus tard le compositeur à ses enfants, «elle était l’épice qui [le] faisait aller de l’avant». Le long solo de violon qui incarne Pauline porte toutes sortes d’indications de jeu changeantes, telles que «joyeux», «espiègle», «tendre, un peu sentimental», «arrogant» ou «très aiguisé». Mais la tendresse l’emporte, et les époux s’abandonnent à l’une des musiques les plus lyriques qu’ait écrites Strauss.
Après avoir dépeint ce petit monde de sa plume incisive, Strauss livre son combat («Le Champ de bataille du Héros»). La musique se fait bruyante, martiale, l’orchestre se déchaîne dans un fracas de timbres et de rythmes. «C’est la plus formidable bataille qu’on ait livré en musique», commenta Romain Rolland sidéré. Peu à peu, le Héros, stimulé par l’amour, acquiert de l’assurance et prend l’ascendant sur ses ennemis. La victoire est signalée par le retour du thème initial. Le Héros peut alors s’adonner à ses «Œuvres de paix» : un glorieux épisode où s’entremêlent toutes sortes de thèmes empruntés à des œuvres antérieures (Don Juan, Ainsi parlait Zarathoustra, Mort et Transfiguration, Don Quichotte, le lied Traum durch die Dämmerung), entrelacés dans un contrepoint d’une rare complexité. La section terminale, «La Fuite du monde et l’Accomplissement du Héros», débute tragiquement puis laisse place à une scène bucolique, au son du cor anglais et de la pulsation sourde des timbales. Les violons émergent de ce silence, montent progressivement en puissance pour se transformer en un thème d’une rare puissance d’émotion. Après un dernier assaut des Philistins, la voix aimante de Pauline s’élève doucement. Puis le thème du héros résonne une dernière fois aux trompettes, enfin pacifié.
– C. D.
Notre partenaire